
Sommaire
On trouvera les textes liturgiques de la Messe et de l’Office ici.
DOM GUÉRANGER, L’ANNÉE LITURGIQUE
Dom Guéranger est décédé alors qu’il écrivait ses commentaires entre la Fête de la Trinité et la Fête-Dieu, son œuvre fut poursuivie par les moines de Solesmes.
Les trois jours entre la Trinité et la Fête-Dieu sont des féries du temps après la Pentecôte : Dom Guéranger en profite pour introduire sur trois jours le mystère qui sera célébré le jeudi, c’est pourquoi nous donnons ici les commentaires des Lundi, Mardi et Mercredi après la Trinité avant de donner le commentaire du jour même de la Fête-Dieu.
I. L’institution de la Fête.
LE LUNDI APRÈS LA TRINITÉ.
La lumière du divin Esprit qui est venue accroître dans l’Église l’intelligence toujours plus vive du souverain mystère de l’auguste Trinité, l’amène à contempler à la suite cette autre merveille qui concentre elle-même toutes les opérations du Verbe incarné, et nous conduit dès cette vie à l’union divine. Le mystère de la très sainte Eucharistie va éclater dans toute sa splendeur, et il importe de préparer les yeux de notre âme à recevoir d’une manière salutaire l’irradiation qui nous attend. De même que nous n’avons jamais été sans la notion du mystère de la sainte Trinité, et que nos hommages se sont toujours dirigés vers elle ; de même aussi la divine Eucharistie n’a cessé de nous accompagner dans tout le cours de cette Année liturgique, soit comme moyen de rendre nos hommages à la suprême Majesté, soit comme aliment de la vie surnaturelle. Nous pouvons dire que ces deux ineffables mystères nous sont connus, que nous les aimons ; mais les grâces de la Pentecôte nous ont ouvert une nouvelle entrée dans ce qu’ils ont de plus intime, et si le premier nous a apparu hier entouré des rayons d’une lumière nouvelle, le second va luire pour nous d’un éclat que l’œil de notre âme n’avait pas perçu encore.
La sainte Trinité, ainsi que nous l’avons fait voir, étant l’objet essentiel de toute la religion, le centre où vont se rendre tous nos hommages, lors même qu’il semble que nous n’y portons pas une intention immédiate, on peut dire aussi que la divine Eucharistie est le plus puissant moyen de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et c’est par elle que la terre s’unit au ciel. Il est donc aisé de pénétrer la raison du retard que la sainte Église a mis à l’institution des deux solennités qui succèdent immédiatement à celle de la Pentecôte. Tous les mystères que nous avons célébrés jusqu’ici étaient contenus dans l’auguste Sacrement qui est le mémorial et comme l’abrégé des merveilles que le Seigneur a opérées pour nous [1]. La réalité de la présence du Christ sous les espèces sacramentelles faisait que, dans l’Hostie sainte, nous reconnaissions au temps de Noël l’Enfant qui nous était né, au temps de la Passion la victime qui nous rachetait, au temps Pascal le glorieux triomphateur de la mort. Nous ne pouvions célébrer tous ces beaux mystères sans appeler à notre secours l’immortel Sacrifice, et il ne pouvait être offert sans les renouveler et les reproduire.
Les fêtes mêmes de la très sainte Vierge et des Saints nous maintenaient dans la contemplation du divin Sacrement. Marie, que nous avons honorée dans ses solennités de l’Immaculée Conception, de la Purification, de l’Annonciation, n’a-t-elle pas fourni de sa propre substance ce corps et ce sang que nous offrions sur l’autel ? La force invincible des Apôtres et des Martyrs que nous avons célébrés, ne l’ont-ils pas puisée dans l’aliment sacré qui donne l’ardeur et la constance ? Les Confesseurs et les Vierges ne nous ont-ils pas apparu comme la floraison du champ de l’Église qui se couvre d’épis et de grappes de raisin, grâce à la fécondité que lui donne Celui qui est à la fois le froment et la vigne [2] ?
Réunissant tous nos moyens pour honorer ces heureux habitants de la cour céleste, nous avons fait appel à la divine psalmodie, aux hymnes, aux cantiques, aux formules les plus pompeuses et les plus tendres ; mais, en fait d’hommages à leur gloire, rien n’égalait l’offrande du Sacrifice. Là, nous entrions en communication directe avec eux, selon l’énergique expression de l’Église au sacré Canon (communicantes). Ils adorent éternellement la très sainte Trinité par Jésus-Christ et en Jésus-Christ ; par le Sacrifice nous nous unissions à eux dans le même centre, nous mêlions nos hommages avec les leurs, et il en résultait pour eux un accroissement d’honneur et de félicité. La divine Eucharistie, Sacrifice et Sacrement, nous a donc toujours été présente ; et si, en ces jours, nous devons nous recueillir pour en mieux comprendre la grandeur et la puissance infinies ; si nous devons nous efforcer d’en goûter avec plus de plénitude l’ineffable suavité, ce n’est point une découverte qui nous apparaît soudain : il s’agit de l’élément que l’amour du Christ nous a préparé, et dont nous usons déjà, pour entrer en rapport direct avec Dieu et lui rendre nos devoirs les plus solennels à la fois et les plus intimes.
Cependant l’Esprit divin qui gouverne l’Église devait lui inspirer un jour la pensée d’établir une solennité [3] particulière en l’honneur du mystère auguste où sont contenus tous les autres. L’élément sacré qui donne à toutes les fêtes de l’année leur raison d’être et les illumine de sa propre splendeur, la très sainte Eucharistie, appelait par elle-même une fête pompeuse en rapport avec la magnificence de son objet.
Mais cette exaltation de la divine Hostie, ces marches triomphales si justement chères à la piété chrétienne de nos jours, étaient impossibles dans l’Église au temps des martyrs. Elles restèrent inusitées après la victoire, comme n’entrant pas dans la manière et l’esprit des formes liturgiques primitives, qui continuèrent longtemps d’être en usage. Elles étaient d’ailleurs moins nécessaires et comme superflues pour la foi vive de cet âge : la solennité du Sacrifice même, la participation commune aux Mystères sacrés, la louange non interrompue des chants liturgiques rayonnant par le monde autour de l’autel, rendaient à Dieu hommage et gloire, maintenaient l’exacte notion du dogme, et entretenaient dans le peuple chrétien une surabondance de vie surnaturelle qu’on ne retrouve plus à l’âge suivant. Le divin mémorial portait ses fruits ; les intentions du Seigneur instituant le mystère étaient remplies, et le souvenir de cette institution, célébré dès lors comme de nos jours à la Messe du Jeudi saint, restait gravé profondément dans le cœur des fidèles.
Il en fut ainsi jusqu’au XIIIe siècle. Mais alors, et par suite du refroidissement que constate l’Église au commencement de ce siècle [4], la foi s’affaiblit, et avec elle la mâle piété des vieilles nations chrétiennes. Dans cette décadence progressive que ne devaient pas arrêter des merveilles de sainteté individuelle, il était à craindre que l’adorable Sacrement, qui est le mystère de la foi par essence, n’eût à souffrir plus qu’aucun autre de l’indifférence et de la froideur des nouvelles générations. Déjà, ici et là, inspirée par l’enfer, plus d’une négation sacrilège avait retenti, effrayant les peuples, trop fidèles encore généralement pour être séduits, mais excitant la vigilance des pasteurs et faisant déjà de nombreuses victimes.
Scot Érigène avait produit la formule de l’hérésie sacramentaire : l’Eucharistie n’était pour lui « qu’un signe, figure de l’union spirituelle avec Jésus, perçue par la seule intelligence » [5]. Son pédantisme obscur eut peu d’écho, et ne prévalut pas contre la tradition catholique exposée dans les savants écrits de Paschase Radbert, Abbé de Corbie. Réveillés au XIe siècle par Bérenger, les sophismes de Scot troublèrent alors plus sérieusement et plus longuement l’Église de France, sans toutefois survivre à l’astucieuse vanité de leur second père. L’enfer avançait peu dans ces attaques trop directes encore ; il atteignit mieux son but par des voies détournées. L’empire byzantin nourrissait, dans ses flancs féconds pour l’hérésie, les restes de la secte manichéenne qui, regardant la chair comme l’œuvre du principe mauvais, renversait l’Eucharistie par la base. Pendant qu’avide de renommée, Bérenger dogmatisait à grand bruit sans profit pour l’erreur, la Thrace et la Bulgarie dirigeaient silencieusement leurs apôtres vers l’Occident. La Lombardie, les Marches et la Toscane furent infectées ; passant les monts, l’impure étincelle éclata sur plusieurs points à la fois du royaume très chrétien : Orléans, Toulouse, Arras, virent le poison pénétrer dans leurs murs. On crut avoir étouffé le mal à sa naissance par d’énergiques répressions ; mais la contagion s’étendait dans l’ombre. Prenant le midi de la France pour base de ses opérations, l’hérésie s’organisa sourdement pendant toute la durée du XIIe siècle ; tels furent ses progrès latents, que, se découvrant enfin, au commencement du XIIIe, elle prétendit soutenir les armes à la main ses dogmes impies. Il fallut des flots de sang pour la réduire et lui enlever ses places fortes ; et longtemps encore après la défaite de l’insurrection armée, l’Inquisition dut surveiller activement les provinces éprouvées par le fléau des Albigeois.
Simon de Montfort avait été le vengeur de la foi. Mais au temps même où le bras victorieux du héros chrétien terrassait l’hérésie, Dieu préparait à son Fils, indignement outrage par les sectaires dans le Sacrement de son amour, un triomphe plus pacifique et une réparation plus complète. En 1208, une humble religieuse hospitalière, la Bienheureuse Julienne du Mont-Cornillon, près Liège, avait une vision mystérieuse, où lui apparaissait la lune dans son plein, montrant sur son disque une échancrure. Quoi qu’elle fît pour chasser ce qu’elle craignait être une illusion, la même vision continua de se présenter invariablement à ses yeux, toutes les fois qu’elle se mettait en prières. Après deux ans d’efforts et de supplications ardentes, il lui fut enfin révélé que la lune signifiait l’Église de son temps, et l’échancrure qu’elle y remarquait l’absence d’une solennité au Cycle liturgique, Dieu voulant qu’une fête nouvelle fût célébrée chaque année pour honorer solennellement et à part l’institution de la très sainte Eucharistie : la mémoire historique de la Cène du Seigneur au Jeudi saint ne répondait pas aux besoins nouveaux des peuples ébranlés par l’hérésie ; elle ne suffisait plus à l’Église, distraite d’ailleurs alors par les importantes fonctions de ce jour, et bientôt absorbée par les tristesses du grand Vendredi.
En même temps que Julienne recevait cette communication, il lui fut enjoint de mettre elle-même la main à l’œuvre et de faire connaître au monde les divines volontés. Vingt années se passèrent avant que l’humble et timide vierge pût prendre sur elle le courage d’une telle initiative. Elle s’en ouvrit enfin à un chanoine de Saint-Martin de Liège, nommé Jean de Lausanne, qu’elle estimait singulièrement pour sa grande sainteté, et le pria de conférer sur l’objet de sa mission avec les docteurs. Tous s’accordèrent à reconnaître que non seulement rien ne s’opposait à l’établissement de la fête projetée, mais qu’il en résulterait au contraire un accroissement de la gloire divine et un grand bien dans les âmes. Réconfortée par cette décision, la Bienheureuse fit composer et approuver pour la future fête un Office propre commençant par ces mots : Animarum cibus [6], et dont il reste encore aujourd’hui quelques fragments.
L’Église de Liège, à qui l’Église universelle devait hier la fête de la Très Sainte Trinité, était prédestinée au nouvel honneur de donner naissance à là fête du Très Saint Sacrement. Ce fut un beau jour, lorsque, en 1246, après un si long temps et des obstacles sans nombre, Robert de Torôte, évêque de Liège, établit par décret synodal que chaque année, le Jeudi après la Trinité, toutes les Églises de son diocèse auraient à observer désormais, avec abstention des œuvres serviles et jeûne préparatoire, une fête solennelle en l’honneur de l’ineffable Sacrement du Corps du Seigneur.
Mais la mission de la Bienheureuse Julienne était loin d’être à son terme : pour avoir trop hésité sans doute à l’entreprendre, Dieu mesurait la joie à sa servante. L’évêque mourut ; et le décret qu’il venait de porter fût resté lettre morte, si, seuls de tout le diocèse, les chanoines de Saint-Martin-au-Mont n’eussent résolu de s’y conformer, malgré l’absence d’une autorité capable d’en presser l’exécution pendant la vacance. La fête du Très Saint Sacrement fut donc célébrée pour la première fois dans cette insigne église, en 1247. Le successeur de Robert, Henri de Gueldre, homme de guerre et grand seigneur, avait d’autres soucis que son prédécesseur. Hugues de Saint-Cher, cardinal de Sainte-Sabine, légat en Allemagne, étant venu à Liège pour remédier aux désordres qui s’y produisaient sous le nouveau gouvernement, entendit parler du décret de Robert et de la nouvelle solennité. Autrefois prieur et provincial des Frères-Prêcheurs, il avait été de ceux qui, consultés par Jean de Lausanne, en avaient loué le projet. Il tinta honneur de célébrer lui-même la fête, et d’y chanter la Messe en grande pompe. En outre, par mandement en date du 29 décembre 1253, adressé aux Archevêques, Évêques, Abbés et fidèles du territoire de sa légation, il confirma le décret de l’évêque de Liège et l’étendit à toutes les terres de son ressort, accordant une indulgence de cent jours à tous ceux qui, contrits et confessés, visiteraient pieusement les églises où se ferait l’Office de la fête, le jour même ou dans l’Octave. L’année suivante, le cardinal de Saint-Georges-au-Voile-d’Or, qui lui succéda dans sa légation, confirma et renouvela les ordonnances du cardinal de Sainte-Sabine. Mais ces décrets réitérés ne purent triompher de la froideur générale ; et telles furent les manœuvres de l’enfer, qui se sentait atteint dans ses profondeurs, qu’après le départ des légats, on vit des hommes d’église, d’un grand nom et constitués en dignité, opposer aux ordonnances leurs décisions particulières.
Quand mourut la Bienheureuse Julienne, en 1258, l’Église de Saint-Martin était toujours la seule où se célébrât la fête qu’elle avait eu pour mission d’établir dans le monde entier. Mais elle laissait, pour continuer son œuvre, une pieuse recluse du nom d’Ève, qui avait été la confidente de ses pensées.
Le 29 août 1261, Jacques Pantaléon montait au trône pontifical sous le nom d’Urbain IV. Né à Troyes, dans la condition la plus obscure, ses seuls mérites avaient amené son élévation. Il avait connu la Bienheureuse Julienne, lorsqu’il n’était encore qu’archidiacre de Liège, et avait approuvé ses desseins. Ève crut voir dans cette exaltation le signe de la Providence. Sur les instances de la recluse, Henri de Gueldre écrivit au nouveau Pape pour le féliciter, et le prier de confirmer de son approbation souveraine la fête instituée par Robert de Torôte. Dans le même temps, divers prodiges, et spécialement celui du corporal de Bolsena, ensanglanté par une hostie miraculeuse presque sous les yeux de la cour pontificale qui résidait alors à Orvieto, semblèrent venir presser Urbain de la part du ciel, et affermir le bon zèle qu’il avait autrefois manifesté pour l’honneur du divin Sacrement. Saint Thomas d’Aquin fut chargé de composer selon le rit romain l’Office qui devait remplacer dans l’Église celui de la Bienheureuse Julienne, adapté par elle au rit de l’ancienne liturgie française. La bulle Transiturus fit ensuite connaître au monde les intentions du Pontife : rappelant les révélations dont, constitué en moindre dignité, il avait eu autrefois connaissance, Urbain IV établissait dans l’Église universelle, en vertu de son autorité apostolique, pour la confusion de l’hérésie et l’exaltation de la foi orthodoxe, une solennité spéciale en l’honneur de l’auguste mémorial laissé par le Christ à son Église. Le jour assigné pour cette fête était la Férie cinquième ou Jeudi après l’octave de la Pentecôte ; car, à la différence du décret de l’évêque de Liège, la bulle ne mentionnait pas la fête de la Très Sainte Trinité, non reçue encore dans l’Église Romaine.
Suivant la voie ouverte par Hugues de Saint-Cher, le Pontife accordait cent jours d’indulgence à tous ceux qui, vraiment contrits et confessés, assisteraient à la Messe ou aux Matines, aux premières ou aux secondes Vêpres de la fête, et quarante jours pour chacune des Heures de Prime, Tierce, Sexte, None et Complies. Cent jours étaient également concédés, pour chacun des jours de l’Octave, aux fidèles qui assisteraient, en ces jours, à la Messe et à l’Office entier. Dans un si grand détail, il n’est point fait mention de la Procession, qui ne s’établit en effet qu’au siècle suivant.
Il semblait que la cause fût enfin terminée. Mais les troubles qui agitaient alors l’Italie et l’Empire firent oublier la bulle d’Urbain IV, avant qu’elle eût pu recevoir son exécution. Quarante ans et plus s’écoulèrent avant qu’elle fût promulguée de nouveau et confirmée par Clément V, au concile de Vienne. Jean XXII lui donna force de loi définitive, en l’insérant au Corps du Droit dans les Clémentines, et il eut ainsi la gloire de mettre la dernière main, vers l’an 1318, à ce grand œuvre dont l’achèvement avait demandé plus d’un siècle.
La fête du Très Saint Sacrement, ou du Corps du Seigneur, marqua le point de départ d’une nouvelle phase dans le culte catholique envers la divine Eucharistie. Mais, pour le bien comprendre, il faut entrer plus avant dans la notion du culte eucharistique aux différentes époques de l’Église : étude importante pour l’intelligence de la grande fête à laquelle nous devons maintenant préparer nos âmes. Nous croyons donc choisir le meilleur mode de préparation que puisse offrir aux fidèles l’Année liturgique, en consacrant les deux jours qui nous restent à rechercher succinctement et brièvement les grandes lignes de l’histoire de la très sainte Eucharistie.
C’est à vous, Esprit-Saint, qu’il appartient de nous apprendre l’histoire d’un si auguste mystère. Votre règne est à peine commencé sur le monde, et, fidèle à cette mission divine qui a pour but la glorification de l’Emmanuel ravi à la terre [7], vous élevez tout d’abord nos regards et nos cœurs vers ce don suprême de son amour qui nous le garde caché sous les voiles eucharistiques. Durant les siècles de l’attente des nations, c’est vous qui déjà présentiez le Verbe au genre humain dans les Écritures, et l’annonciez par les Prophètes [8]. Don premier du Très-Haut [9], vous êtes, comme amour infini, la raison substantielle et souveraine des manifestations divines ; ainsi attirâtes-vous ce Verbe divin au sein de la Vierge immaculée, pour l’y revêtir de la chair virginale qui le fit notre frère et notre Sauveur. Et maintenant qu’il est remonté vers son Père et notre Père [10], dérobant à nos yeux cette nature humaine ornée par vous de tant de perfections et d’attraits vainqueurs, maintenant qu’il nous faut reprendre sans lui les pérégrinations de cette vallée des larmes, envoyé par lui [11], vous êtes venu, divin Esprit, comme le consolateur. Mais la consolation que vous nous apportez, ô Paraclet, c’est toujours son fidèle souvenir [12], c’est encore plus sa divine présence gardée par vous au Sacrement d’amour. Nous le savions d’avance : vous ne deviez pas agir ni parler de vous-même [13], ou pour vous-même ; vous veniez rendre témoignage à l’Emmanuel [14], maintenir son œuvre et reproduire en chacun de nous sa divine ressemblance.
Qu’il est admirable l’accomplissement de cette mission sublime, tout entière à la gloire de l’Emmanuel ! Esprit divin, gardien du Verbe dans l’Église, nous ne pouvons redire ici votre vigilance sur cette divine parole apportée par Jésus au monde, expression très fidèle de lui-même, et qui, sortie comme lui de la bouche du Père, nourrit aussi l’Épouse ici-bas [15]. Mais de quel respect infini, de quelle sollicitude n’entourez-vous pas le Sacrement auguste où réside tout entier, dans la réalité de sa chair adorable, ce même Verbe incarné qui fut dès l’origine du monde le centre et le but de vos divines opérations ! Par votre toute-puissance produisant le mystère, l’Épouse exilée se retrouve en possession de l’Époux ; par vous elle traverse les siècles, gardant chèrement son trésor ; par vous elle le fait valoir avec une délicatesse infinie, ordonnant, modifiant sa discipline et sa vie même, pour assurer dans tous les âges au divin Sacrement la plus grande somme possible de foi, de respect et d’amour. Qu’elle le dérobe anxieuse à la connaissance des profanes, qu’elle accumule autour de lui dans la Liturgie ses pompes et ses magnificences, ou que, sortant avec lui des temples, elle le promène triomphalement dans les rues des cités populeuses ou les sentiers fleuris des campagnes, c’est vous, divin Esprit, qui l’inspirez ; c’est votre divine prévoyance qui lui suggère, selon les temps, la plus sûre manière de conquérir à l’Emmanuel, toujours présent dans l’Hostie, les hommages et les cœurs de ces enfants des hommes, au milieu desquels il daigne trouver ainsi jusqu’à la fin les délices de son amour [16].
Daignez nous assister dans la contemplation de l’auguste mystère. Éclairez les intelligences, échauffez les cœurs en ces jours de préparation ; révélez à nos âmes Celui qui vient à nous sous les voiles du Sacrement.
Dans la dernière partie de cette Année liturgique, qu’il soit pour nous le pain du voyageur. Une longue route nous reste encore à parcourir, bien différente de celle que nous avons suivie jusqu’ici en compagnie du Seigneur et de ses mystères, route laborieuse à travers le désert qui nous sépare de la montagne de Dieu [17]. Esprit-Saint, vous serez notre guide dans ces sentiers où l’Église, conduite par vous, marche avec courage, se rapprochant chaque jour du terme de son pèlerinage ici-bas. Mais vous-même nous amenez dès le début à ce banquet de la divine Sagesse [18] où le pèlerin trouve sa vigueur. Nous marcherons dans la force du mets céleste [19] ; c’est par lui encore que, la course achevée, de concert avec l’Esprit et l’Épouse, nous ferons retentir l’invincible appel de l’heure suprême qui nous rendra le Seigneur Jésus [20].
A la gloire de l’auguste Sacrement, et pour honorer la Bienheureuse Julienne, à qui l’Église est si redevable en ces jours, nous donnerons comme pièces liturgiques, aujourd’hui et dans l’Octave, les principaux fragments parvenus jusqu’à nous de l’Office qui porte son nom. Mais on nous saura gré de citer ici préalablement quelques traits de l’historien de la Bienheureuse sur la manière dont cet Office fut composé :
« Julienne donc se prit à penser qui elle inviterait à la composition de l’Office d’une si grande solennité. Or, faisant réflexion qu’elle n’avait sous la main ni hommes lettrés, ni clercs excellents qui fussent propres à cela par eux-mêmes, confiante en la divine Sagesse, elle choisit en son cœur un tout jeune frère de sa maison, nommé Jean [21], que Dieu lui avait attaché d’une façon mystérieuse. Mais lui, sachant bien qu’une telle œuvre excédait la mesure de son génie et de sa science, étant de peu de littérature, commença par hésiter et s’excuser sur son ignorance. Julienne, qui, sachant tout cela, savait aussi que la divine Sagesse, dont c’était l’œuvre, peut dire par un ignorant de belles choses, fit tant que, vaincu par les prières et l’autorité de la vierge, il commença de travailler. Et ainsi advint-il que ce jeune frère et la vierge du Christ unissant leurs efforts, elle priant, lui écrivant, l’œuvre se poursuivit plus facilement qu’il n’eût pu s’y attendre. Aussi attribuait-il aux prières de la vierge, plus qu’à son travail, ce qu’il pouvait faire, et lorsqu’il avait achevé quelque chose du susdit Office, il le lui apportait, disant : « Voici, Madame, qui vous est envoyé d’en haut ; examinez, et voyez s’il n’y a rien à changer dans le chant ou la lettre. » Elle, par son admirable science infuse, quand il en était besoin, le faisait avec si grande prudence et habileté, qu’après son examen et correction, il ne fut jamais nécessaire de requérir même le poli des maîtres de la science. Ainsi fut consommé, par un merveilleux secours de Dieu, l’Office entier delà nouvelle fête » [22].
Les Antiennes que nous donnons ici sont tirées par les Bollandistes [23] d’un très ancien Directorium de l’Église Saint-Martin-au-Mont. Elles s’y trouvent assignées aux Benedictus et Magnificat de chacun des jours dans l’Octave.
| ANTIENNES. | |
| Animarum cibus Dei Sapientia nobis carnem assumptam proposuit in edulium, ut per cibum hujus pietatis invitaret ad gustum divinitatis. | Mets des âmes, la divine Sagesse, revêtant chair, nous la propose en aliment, afin que par cette nourriture d’amour elle nous amène à goûter Dieu. |
| Discipulis competentem conscribens hereditatem, sui memoriam commendavit inquiens : Hoc facite in mei commemorationem. | Dressant pour ses disciples un testament auguste, elle leur recommande son souvenir, disant : Faites ceci en mémoire de moi. |
| Totum Christus se nobis exhibet in cibum, ut sicut divinitus nos reficit quem corde gustamus, ita nos humanitus reficiat quem ore manducamus ; | Le Christ tout entier se donne à nous en nourriture : ainsi que nous répare dans sa divinité Celui que goûte notre cœur, ainsi nous rétablit par son humanité Celui que mange notre bouche ; |
| Et sic de visibilibus ad invisibilia, de temporalibus ad æterna, de terrenis ad cœlestia, de humanis ad divina nos transferat. | Ainsi nous fait-il passer du visible à l’invisible, du temps à l’éternité, de la terre au ciel, de l’homme à Dieu. |
| Panem angelorum manducavit homo, ut qui secundum animum cibum divinitatis accipimus, secundum carnem cibum humanitatis sumamus : quia sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus. | L’homme a mangé le nain des anges ; comme la divinité nourrit l’esprit, ainsi l’humanité nourrit la chair : l’âme raisonnable et la chair est un seul homme. Dieu et l’homme un seul Christ. |
| Panis vitæ, panis angelorum, Jesu Christe vera mundi vita, qui semper nos reficis, in te nunquam deficis, nos ab omni sana languore ut te nostro viatico in terra recreati, te ore plenissimo manducemus in æternum. | Pain de vie, pain des anges, Jésus, vraie vie du monde, qui toujours nous ranimez sans jamais défaillir, guérissez-nous de toute langueur, afin que, raffermis par vous notre viatique en terre, nous vous goûtions pleinement au festin éternel. |
| Suo Christus sanguine nos lavat quotidie, cum ejus beatæ passionis quotidie memoria renovatur. | Le Christ nous lave dans son sang tous les jours, étant renouvelée tous les jours la mémoire de sa bienheureuse passion. |
| Sanguis ejus non infidelium manibus ad ipsorum perniciem funditur ; sed quotidie fidelium suavi ore sumitur ad salutem. | Son sang n’est point répandu par des mains infidèles pour leur malheur ; mais tous les jours il est aspiré doucement pour leur salut par des bouches fidèles. |
| Verus Deus, verus homo semel in cruce pependit, se Patri redemptionis hostiam efficacem offerens : semper tamen invisibiliter est in mysterio, non passus sed quasi pati repræsentatus. | Une seule fois suspendu à la croix, vrai Dieu, vrai homme, il s’est offert au Père hostie efficace de rédemption ; toujours cependant il est dans l’impénétrable mystère, non souffrant, mais rendu présent comme dans la souffrance. |
| Dominus Jesus Christus sine vulnere quotidie sacrificatus, mortalibus in terra præstitit cœlesti fungi ministerio. | Chaque jour sacrifié sans blessure, le Seigneur Jésus-Christ donne à des mortels d’accomplir sur terre un ministère céleste. |
| Hæc igitur singularis victima Christi mortis est recordatio, scelerum nostrorum expurgatio, cunctorum fidelium devotio, et æternæ vitæ adeptio. | Sacrifice vraiment unique, c’est le souvenir de la mort du Christ, le pardon de nos crimes, l’amour des fidèles, et le gage de l’éternelle vie. |
| AD ORATIONEM DOMINICAM. | |
| (Dominica ante jejunium Calend. Novembr.) | |
| Accepturi, fratres carrissimi, intra mortalia viscera cœleste sacrificium,et intra cubiculum humani pectoris hospitem Deum : mundemus conscientias nostras ab omni labe vitiorum : ut nihil sit in nobis subdolum vel superbum ; sed in humilitatis studium et charitatis assensum per escam et sanguinem Domini corporis fraternitas cuncta copuletur, ut cum fiducia dicere mereamur e terris : Pater noster qui es in cœlis. | Appelés, frères très chers, à recevoir dans des entrailles mortelles le Sacrifice des cieux, à loger Dieu comme hôte dans l’habitation d’une poitrine humaine, purifions nos consciences de toute souillure des vices ; que ne soient en nous ni fausseté, ni superbe ; mais soyons humbles, d’accord dans la charité, pour que la chair et le sang du Seigneur unissent tous les frères en son corps, et que, de cette terre, nous puissions dire avec confiance : Notre Père qui êtes aux cieux. |
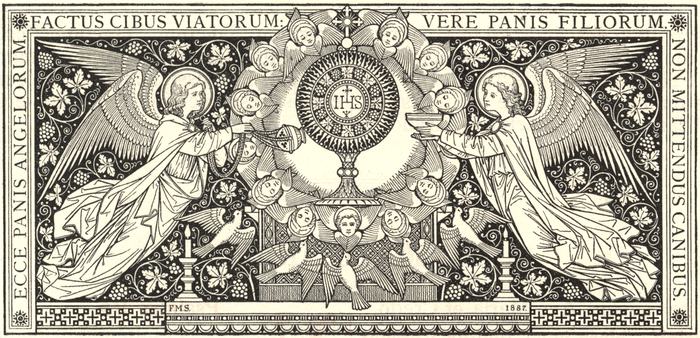
II. L’Eucharistie dans l’antiquité.
LE MARDI APRÈS LA TRINITE.
L’histoire de la très sainte Eucharistie se confond avec celle de l’Église ; les formes liturgiques qui accompagnent le plus auguste des Sacrements ont suivi, dans leur marche rituelle, les grandes phases sociales de la chrétienté. Il en devait être ainsi, l’Eucharistie étant ici-bas le centre vital où tout converge dans l’Église, le lien puissant de cette société dont le Christ est le chef, et par laquelle il doit régner sur les nations appelées à former son héritage [24]. L’union à Pierre vicaire de l’Homme-Dieu sera toujours la condition nécessaire, le signe extérieur de l’union des membres au Chef invisible ; mais, appuyé ineffablement sur le roc qui porte l’Église, l’auguste mystère où le Christ se donne lui-même à chacun des siens n’en demeure pas moins le mystère de l’union par essence, et comme tel, le centre et le lien de la grande communion catholique. Prenons aujourd’hui possession de cette vérité fondamentale qui présida dans l’origine à la formation même de l’Église, et considérons l’influence qu’elle eut sur les formes du culte eucharistique aux douze premiers siècles. Demain, nous verrons comment le relâchement, l’hérésie et la défection sociale amenèrent l’Église à modifier insensiblement des formes accidentelles du reste, et qui convenaient mieux à des temps meilleurs, pour diriger dans le sens de besoins nouveaux la religion de ses enfants restés fidèles.
Ce fut la veille de sa Passion que le Seigneur institua le mémorial destiné à perpétuer en tous lieux l’unique Sacrifice qui devait consommer la sanctification des élus [25]. Sur la croix devenue, comme l’appelle saint Léon, « l’autel du monde » [26], avait lieu quelques heures plus tard, d’après le même saint docteur, l’oblation de la nature humaine tout entière, inséparable de son Chef dans cet acte suprême d’adoration et de réparation [27]. Mais, sortie avec le sang et l’eau du côté du Sauveur, l’Église n’était qu’à sa naissance ; le mystère de cette union divine que l’Homme-Dieu était venu réaliser sur la terre, en rattachant par lui au Père dans l’Esprit-Saint les membres de son corps mystique, ne devait avoir que successivement pour chacun d’eux son accomplissement immédiat. De la l’invention sublime de la dernière Cène : Testament nouveau, qui constituait l’Épouse à naître en la possession du mystère où chaque génération se rattacherait aux précédentes dans l’unité du Sacrifice, et trouverait dans cette même unité le lien mutuel de ses membres.
« Je vous donne un commandement nouveau », avait dit le Sauveur instituant la nouvelle Pâque : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ; à cela tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » [28]. Tel fut le premier précepte, tel devait être le signe de l’alliance que le Seigneur contractait alors par ses Apôtres avec tous ceux qui devaient croire en lui car leur parole [29]. Et sa première prière, après cette première distribution de son corps et de son sang sous les espèces eucharistiques, est encore pour l’union de ses fidèles entre eux, union ineffable et toute singulière comme l’ineffable mystère qui doit en faire le nœud et l’aliment, union si intime que son union même avec le Père en peut seule fournir le type au Sauveur : « Père saint, que tous ils soient un en nous, qu’ils soient un comme nous-mêmes ; que, moi en eux et toi en moi, ils soient consommés dans l’unité » [30].
Formée par l’Esprit-Saint, l’Église, dès ses débuts, comprit les intentions du Sauveur. Les trois mille élus du jour de la Pentecôte sont représentés, au livre des Actes, « persévérant dans la doctrine des Apôtres, la communion de la fraction du pain et la prière » [31]. Or, telle est la force intime de cohésion puisée dans la participation au pain mystérieux, qu’en face de la synagogue ils apparaissent dès lors comme une société distincte, inspirant à tout le peuple une crainte respectueuse et attirant chaque jour de nouveaux membres [32].
Quelques années plus tard, franchissant sous le souffle de l’Esprit les bornes d’Israël, l’Église porte à la gentilité ses trésors. Aux regards stupéfaits d’un monde dont tous les liens brisés n’opposent plus que la tyrannie de César aux égoïsmes individuels, elle offre bientôt, de l’Orient au Couchant, le spectacle de cette société nouvelle qui, recrutant ses membres à tous les degrés sociaux, sous toutes les latitudes, et par la seule persuasion de la vertu, demeure plus forte et plus unie qu’aucune nation dans l’histoire. L’étranger admire ce phénomène qu’il ne comprend pas ; sans le savoir, sans entrer plus avant, il rend témoignage au fidèle accomplissement des intentions dernières du fondateur de l’Église, par ces mots qui tombent de ses lèvres : « Voyez comme ils s’aiment [33] ! »
Aux fidèles seuls, aux initiés, l’Apôtre explique le mystère : Nous sommes tous un même pain, nous sommes un seul corps, nous tous qui participons à l’unique pain [34].
Saint Augustin, parlant aux néophytes à peine sortis de la fontaine sacrée, commente admirablement ce passage : « J’ai promis aux nouveaux baptisés de leur exposer le mystère de la table du Seigneur. Ce pain que vous voyez sur l’autel, sanctifié par la parole divine, c’est le corps du Christ ; ce calice, ce qu’il contient, c’est son sang versé pour nos péchés. Si vous le recevez comme il faut, c’est vous tous, vous-mêmes que vous recevez. Car l’Apôtre dit : Nous sommes tous un seul pain, un seul corps, montrant ainsi quel amour il faut avoir de l’unité. Ce pain n’a pas été fait d’un seul grain, mais d’un grand nombre. Avant leur transformation, ils étaient séparés ; l’eau les a réunis, après le broiement qu’ils ont dû subir. Vous aussi naguère vous étiez comme moulus par le jeûne et les exorcismes ; l’eau du baptême est arrivée qui vous a pétris en la forme du pain. Mais au pain le feu encore est nécessaire. Qu’est-ce que le feu ? c’est le chrême : l’huile est le symbole a de notre feu, de l’Esprit-Saint. Vient donc le Saint-Esprit, après l’eau le feu, et vous devenez ainsi ce pain qui est le corps du Christ. Il a voulu que nous fussions nous-mêmes son Sacrifice ; nous sommes, nous aussi, le Sacrifice de Dieu. Grands et ineffables Mystères ! Recevez-les avec tremblement, gardant l’unité dans vos cœurs [35]. Soyez un dans votre amour, d’une seule foi, d’une seule espérance, d’une indivisible charité. Quand les hérétiques approchent de ce pain, c’est leur condamnation qu’ils reçoivent ; car ils cherchent la division, et ce pain marque l’unité [36]. L’Écriture dit des fidèles : « Ils n’avaient qu’un cœur et qu’une âme » [37] ; et c’est ce qui est encore marqué par le vin des Mystères sacrés. Nombre de grains pendent de la grappe ; mais la liqueur des grains se confond dans l’unité du calice. Ainsi de nouveau le Seigneur Christ a-t-il voulu signifier notre a union avec lui, ainsi a-t-il consacré par sa table sainte le mystère de la paix et de notre unité » [38].
Ces admirables développements du grand évoque d’Hippone ne sont que l’exposé substantiel de la doctrine eucharistique dans l’Église au IVe siècle. C’est la notion élémentaire, dans sa plénitude et sa clarté sans figures ; car on ne pouvait en offrir d’autre à des néophytes retenus jusque-là par la loi du secret, dont nous parlerons bientôt, dans l’ignorance absolue des Mystères augustes auxquels ils devaient participer désormais. La doctrine exposée par saint Augustin dans sa chaire d’Hippone se retrouve la même en tous lieux dans la bouche des docteurs. Dans les Gaules saint Hilaire de Poitiers [39], saint Césaire d’Arles [40], en Italie saint Gaudentius de Brescia [41], saint Jean Chrysostome à Antioche et à Constantinople [42] saint Cyrille sur le siège patriarcal d’Alexandrie [43], ne présentent pas autrement le dogme à leurs peuples : on ne divise pas le Christ ; le chef et les membres, le Verbe et son Église, demeurent inséparables dans l’unité du mystère institué pour cette union même. Et cet enseignement unanime des Pères aux siècles d’or de l’éloquence chrétienne, Paschase Radbert le reproduit dans sa plénitude au IXe siècle [44], Rupert le redit aux échos du XIIe [45], Guillaume d’Auvergne s’en inspire encore au commencement du XIIIe [46].
Nous ne pourrions nommer, encore moins citer ici tous les témoins de l’accord des Églises sur cette notion du dogme eucharistique aux douze premiers siècles. Remontant le fleuve de la tradition vers la source apostolique où il prend naissance, nous rencontrons, à l’âge des persécutions, l’illustre évêque martyr, saint Cyprien, démontrant, lui aussi, la nécessaire union du chef et des membres au divin Sacrement, non seulement par la nature du pain et du vin, éléments essentiels de la consécration des Mystères, mais encore par le mélange de l’eau avec le vin dans le calice eucharistique : l’eau signifie le peuple fidèle, le vin marque le sang du Christ ; leur union dans le calice, union nécessaire à l’intégrité du Sacrifice, union complète et sans retour possible, exprime l’indissoluble alliance du Christ et de l’Église qui parfait le Sacrement [47]. L’unité de l’Église par la chaire de Pierre, objet d’un de ses plus beaux ouvrages, l’évoque de Carthage la montre ailleurs établie divinement sur les Mystères sacrés ; il décrit avec complaisance, dans une de ses lettres [48], la multitude des croyants, l’unanimité chrétienne, maintenue dans les liens d’une ferme et indivisible charité par le Sacrifice du Seigneur. Le Christ au Sacrement, le Christ en son Vicaire, n’est en effet qu’une même pierre portant l’édifice, un seul chef, ici visible dans son représentant, là invisible en sa propre substance.
C’était bien la pensée de cette Église du premier âge qui, chargée de réunir en un même centre les enfants de Dieu dispersés par le monde [49], leur donnait pour signe de reconnaissance au milieu des ennemis l’ICHTHUS mystérieux, le poisson sacré, symbole des Mystères. On sait que les lettres dont se compose le mot ichthus, nom grec du poisson, donnent en cette langue les initiales de la formule : Jésus-Christ Fils de Dieu, Sauveur ; et le poisson lui-même nous apparaît, dans l’histoire de Tobie [50], comme la figure du Christ en personne, nourrissant le voyageur de sa substance, chassant les démons ennemis par sa vertu salutaire, et rendant la lumière au monde envieilli. Aussi n’est-ce point sans une raison prophétique et mystérieuse qu’il nous est montré, dans la Genèse, béni par Dieu comme l’homme même aux premiers jours du monde [51]. Il accompagne le pain dans ces multiplications miraculeuses de l’Évangile, où s’annoncent et se dessinent par avance les merveilles eucharistiques. Rôti sur les charbons, il reparaît encore, après la résurrection du Seigneur, uni au pain dans le repas offert par le Christ aux sept disciples sur les bords du lac de Tibériade [52]. Or, nous disent les Pères, le Christ est le pain de ce festin mystérieux ; il est le poisson d’eau vive qui, rôti sur l’autel de la croix par le feu de l’amour, rassasie de lui-même ses disciples, et s’offre au monde entier vraiment ICHTHUS [53]. Aussi n’est-il pas de symbole plus fréquemment exprimé dans les monuments chrétiens de tout genre aux trois premiers siècles : pierres gravées, anneaux, lampes, inscriptions, peintures, reproduisent le Poisson sous toutes les formes. Il est bien le signe de ralliement, la tessère des chrétiens en ces siècles du martyre. « Race divine de l’ICHTHUS céleste, au cœur magnanime, ils reçoivent du Sauveur des Saints l’aliment doux comme le miel, et s’abreuvent à longs traits aux sources divines de l’éternelle Sagesse, tenant ICHTHUS en leurs mains » [54]. Ainsi nous les montre, au second siècle, un monument célèbre de notre terre des Gaules. Et dans le même temps, un saint évêque d’Asie-Mineure, Abercius d’Hiéropolis, conduit par Dieu sur plus d’un rivage, reconnaît partout les disciples du Christ au Poisson sacré qui les fait un malgré les distances. « Disciple du Pasteur immaculé qui paît ses troupeaux parles plaines et les monts, j’ai vu Rome », dit-il au dernier terme de sa vie voyageuse ; « j’ai contemplé la reine à la robe d’or, aux chaussures d’or ; j’ai connu le peuple au front marque d’un sceau splendide [55]. J’ai visité les campagnes de la Syrie et toutes ses villes. Passant l’Euphrate, j’ai vu Nisibe, et partout j’ai trouvé des frères : la foi qui partout fut mon guide m’offrait pour aliment, servait partout aux bien-aimés, dans les délices du pain et du vin mélangé, l’ICHTUS auguste, saisi par une Vierge très pure à la source sacrée » [56].
Tel était donc le lien de cette unité puissante du christianisme, objet de stupeur pour le monde païen qui se ruait contre elle avec d’autant plus de furie, que la vraie cause en demeurait plus soigneusement cachée à ses yeux. « Ne livrez pas les choses saintes aux chiens, n’exposez pas vos perles aux pourceaux » [57], avait dit le Seigneur, posant ainsi les bases de celte discipline du secret qui fut en vigueur dans l’Église jusqu’à la complète conversion du monde occidental. La sainteté mystérieuse des Sacrements, la sublimité des dogmes chrétiens, imposaient la plus extrême réserve aux fidèles, en face d’une société dont la dégradation morale et la brutale corruption ne justifiaient que trop les expressions du Sauveur. Mais c’était surtout la très sainte Eucharistie, « cette perle sans prix du corps de l’Agneau » [58], qu’il convenait de dérober aux regards indignes et aux profanations sacrilèges. Aussi voyons-nous les assemblées chrétiennes régies en ces temps par la distinction fondamentale des initiés et de ceux qui ne le sont pas, des fidèles, et des catéchumènes : distinction scrupuleusement observée dès l’âge apostolique, et qui persévéra jusqu’au VIIIe siècle. Quelques semaines avant l’administration solennelle du baptême, avait lieu, comme nous l’avons vu ailleurs [59], la tradition du Symbole aux futurs membres de l’Église ; toutefois le mystère eucharistique, l’arcane par excellence, restait caché même alors aux élus inscrits déjà pour le saint baptême. De là les précautions multipliées de langage, les réticences, les obscurités calculées des Pères dans leurs discours, longtemps encore après Constantin et Théodose. On admettait les catéchumènes à la lecture des Écritures et au chant des psaumes, qui formaient comme l’introduction au divin Sacrifice ; mais, après le discours de l’évoque sur l’Évangile ou les autres parties de l’Écriture qu’on venait d’entendre, ils étaient congédiés parle diacre, et ce renvoi ou missa, de missio, donnait son nom à cette première partie de la Liturgie, dite Messe des catéchumènes, comme la seconde, qui s’étendait de l’oblation au renvoi final, s’appelait Messe des fidèles pour une raison semblable.
Mais si l’Église veillait jalousement sur son trésor, au point de n’en livrer la connaissance qu’à ses seuls vrais enfants devenus tels par le baptême, avec quel amour, aux fêtes de Pâques et de la Pentecôte, elle révélait à ses nouveau-nés sortant des eaux l’ineffable secret de son cœur d’Épouse, le mystère complet de l’ICHTUS ! Incorporés au Christ sous les flots, enrôlés dans l’armée sainte et marqués du signe de ses soldats par l’onction du pontife, avec quelle tendresse maternelle elle les conduisait, du baptistère et du chrismarium, au lieu sacré des Mystères institués par l’Époux ! C’était là, en effet, qu’en personne le Christ chef attendait ses nouveaux membres ; là qu’il devait resserrer en eux ineffablement les liens de son corps mystique, associant avec lui tous les baptisés dans l’hommage infini du Sacrifice unique offert au Père !
Cette admirable unité du Sacrifice eucharistique, embrassant dans son oblation toujours la même le Chef et les membres, maintenant et fortifiant l’union de chaque communauté chrétienne et de l’Église entière, était merveilleusement exprimée par les formes grandioses de la Liturgie primitive. Après le renvoi des catéchumènes et l’expulsion des indignes, tous les fidèles sans distinction, depuis l’empereur et sa cour, jusqu’au dernier des citoyens et aux plus humbles femmes, se présentaient offrant leur part du pain et du vin destinés aux Mystères. Eux-mêmes, sacerdoce royal [60], hostie vivante figurée par ces dons, ils assistaient debout à l’immolation de la grande Victime dont ils étaient les vrais membres ; et s’unissant tous dans le saint baiser en signe d’union des cœurs, debout encore, ils recevaient dans leurs mains le Corps sacré pour s’en nourrir, et s’abreuvaient du Sang divin au calice présenté par les diacres. Portés sur les bras de leurs mères, les plus jeunes enfants aspiraient quelques gouttes du Sang précieux dans leur bouche innocente. Les malades retenus par la souffrance, les prisonniers du fond de leurs cachots, s’unissaient à leurs frères au divin banquet, recevant les dons sacrés de la main des ministres envoyés vers eux par le pontife. Les anachorètes du désert, les chrétiens des campagnes et tous ceux qui ne pouvaient se retrouver à la prochaine assemblée, emportaient avec eux le Corps du Seigneur, pour ne pas être frustrés par leur éloignement de la communion aux Mystères du salut. En ces siècles où l’Église voyait le plus souvent son unité attaquée à la fois par la persécution, le schisme et l’hérésie, elle ne croyait pouvoir excéder, en multipliant sous toutes les formes l’usage et les applications du Sacrement auguste, signe de L’unité, centre intime et lien puissant de la famille chrétienne.
C’est dans cette même pensée d’unité que, bien qu’il y eût d’ordinaire en chaque ville plusieurs églises ou centres de réunion pour les fidèles, et un clergé plus ou moins nombreux, tous cependant, fidèles et clercs, se réunissaient pour la collecte ou synaxis, en un seul lieu désigné par l’évêque. « Où est l’évêque, là soit le peuple », dit saint Ignace d’Antioche en ses Épîtres, « de même qu’où se a trouve le Christ Jésus, là est l’Église catholique. Ne tenez pour légitime Eucharistie que celle qui est célébrée sous la présidence de l’évêque ou de celui qu’il désigne [61]. Assemblez-vous tous dans l’unité : unité de prières, unité de désirs, unité de pensées, unité d’espérance, en dilection mutuelle et sainte allégresse. N’espérez pas faire en votre particulier rien qui vaille. Jésus-Christ est un [62]. Qu’une soit donc votre Eucharistie, comme une est la chair du Seigneur, un le calice qui nous unit dans son sang, un l’autel, un l’évêque entouré du presbyterium et des diacres » [63].
Le presbyterium était le collège des prêtres de chaque cité ; ils entouraient l’évêque, formaient son conseil, et célébraient avec lui les fonctions sacrées. Au nombre de douze, ainsi qu’il semble, à l’origine, pour représenter le sénat apostolique, ce chiffre fut promptement doublé dans les grandes villes. Dès la fin du premier siècle, il y avait à Rome vingt-cinq prêtres, préposés aux vingt-cinq Titres ou églises de la ville reine. Le pontife se transportait d’un Titre à l’autre pour la célébration des Mystères ; siégeant autour de lui, les vingt-quatre prêtres des autres Titres s’unissaient au pontife dans la solennité d’un même Sacrifice et concélébraient au même autel. A leurs places respectives, les sept diacres et tous les clercs inférieurs coopéraient, selon leur Ordre, aux Mystères trois fois saints. Nous avons vu la part active qu’y prenait le peuple fidèle.
C’était le temps où, de son regard inspiré, l’Aigle de Pathmos contemplait au ciel l’Agneau immolé, debout au milieu des vingt-quatre vieillards entourant sur leurs trônes le trône même de Dieu, qui est aussi celui du Pontife éternel. Vêtus de robes blanches, le front ceint du diadème, ils tenaient en leurs mains des cithares et des coupes d’or pleines de parfums qui sont les prières des saints. A leur suite et avec eux, les sept esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu comme sept lampes ardentes, et les milliers d’anges qui l’entourent, chantaient le Sacrifice de l’Agneau et son triomphe. Et toute créature, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, rendait bénédiction, hommage, gloire, puissance, à Celui qui vit dans les siècles [64]. Vision merveilleuse, exprimant la plénitude et l’unité du Sacrifice offert une fois, pour durer toujours, par l’auguste chef de la création ! Scène sublime de la patrie, que l’Épouse exilée s’efforçait de reproduire en cette vallée des larmes ! Comme au ciel l’Agneau divin, Pontife éternel, entraîne à sa suite les bienheureuses hiérarchies dans sa marche triomphante, ainsi chacune des Églises de la terre, image de la céleste Jérusalem, accompagnait-elle l’évêque, se groupant autour de lui dans l’harmonie parfaite de ses différents Ordres.
Soumise encore aux conditions terrestres, entravée dans les liens de l’espace et du temps, l’Église militante ne pouvait, il est vrai, se réunir ici-bas tout entière au même autel ; mais l’unité du Sacrifice offert dans le monde entier était exprimée, comme l’unité de l’Église elle-même, par l’envoi mutuel que se faisaient les évêques catholiques des saintes espèces consacrées par eux, et le mélange qu’ils accomplissaient réciproquement de ces dons sacrés dans leur propre calice. Nous apprenons de saint Irénée [65] qu’au second siècle, le Pontife de Rome, l’hiérarque suprême, dirigeait au delà des limites de l’Occident, jusqu’en Asie, ces signes augustes de l’union avec l’Église mère et maîtresse. De même, lorsque la multitude toujours croissante des fidèles amena l’Église à permettre aux prêtres isolés la célébration des Mystères, les prêtres de la ville épiscopale ne procédaient point à cette oblation séparée, sans avoir reçu de l’évêque une part du pain consacré qu’ils mélangeaient à leur Sacrifice. C’était le fermentum, ou levain sacré de la Communion catholique.
Les considérations qui précèdent trouveront leur couronnement dans cette belle formule liturgique que nous empruntons aux Constitutions apostoliques [66], ouvrage dont la rédaction définitive reste fixée par la science au troisième siècle de l’Église.
ACTION DE GRÂCES SUR LES MYSTÈRES.
Nous vous rendons grâces, ô notre Père, pour la vie que vous nous avez révélée par Jésus votre Fils : par qui vous avez créé toutes choses, et exercez sur toutes votre providence ; que vous avez envoyé, se faisant homme pour notre salut ; dont vous avez permis les souffrances et la mort ; que vous avez voulu glorifier, en le ressuscitant et le faisant asseoir à votre droite ; par qui vous avez promis à nous aussi la résurrection des morts.
O vous, Seigneur tout-puissant, Dieu éternel : de même que ces éléments qui étaient dispersés d’abord, étant réunis, n’ont plus fait qu’un seul pain, ainsi rassemblez votre Église des extrémités de la terre en votre royaume.
Nous rendons grâces encore, ô notre Père, pour le sang précieux de Jésus-Christ répandu pour nous, et pour son précieux corps, dont nous célébrons en ce moment les Mystères, lui-même nous ayant ordonné d’annoncer ainsi sa mort : par lui à vous la gloire dans les des siècles. Amen.
Dans le même ordre de pensées, la Liturgie ambrosienne nous donne aujourd’hui encore la Préface qui suit, indiquée chez elle pour le Dimanche avant la Septuagésime.
| PRÉFACE. | |
| Dignum et justum est, æterne Deus : Et tibi sacrosanctam hanc Hostiam immolare : quæ salutifero et ineffabili divinæ gratiæ sacramento offertur a plurimis, et unum Christi corpus Sancti Spiritus infusione efficitur. Singuli accipiunt Christum Dominum, et in singulis portionibus est totus ; nec per singulos minuitur, sed integrum se præbet in singulis. Propterea ipsi qui sumimus communionem hujus sancti Panis et Calicis, unum corpus efficimur. Per ipsius itaque Majestatem te supplices exoramus : ut nos ab omnibus emundes contagiis vetustatis, et in novitate vitæ perseverare concedas. | C’est une chose digne et juste, Dieu éternel, de vous immoler cette sainte et sacrée Hostie. Ineffable mystère de la divine grâce opérant le salut ! L’offrande de plusieurs devient par l’intervention de l’Esprit-Saint l’unique corps du Christ. Chacun reçoit le Seigneur Jésus-Christ, et dans chaque part il est entier ; la distribution ne le diminue pas, mais il se donne à tous et chacun dans sa plénitude. C’est pourquoi nous-mêmes qui recevons la communion de ce Pain sacré et de ce Calice, nous devenons un seul corps. Par sa Majesté donc nous vous supplions humblement que votre grâce nous purifie de toute souillure de vétusté, et nous fasse persévérer dans cette vie nouvelle. |

III. Moyen Âge, hérésies, affirmation de la foi.
LE MERCREDI APRÈS LA TRINITÉ.
Le jour qui commence n’est point encore celui de la fête du divin Mémorial : c’est demain seulement qu’elle doit éclater dans sa splendeur. Mais dès ce soir, aux premières Vêpres, l’Église acclamera le Pontife éternel ; et si les papes n’ont point voulu faire précéder d’une Vigile proprement dite la solennité du Corps du Seigneur, des indulgences [67] sont cependant accordées, dans leurs bulles, au jeûne volontaire en ce jour qui la précède immédiatement. Reprenons maintenant nos considérations historiques sur l’auguste mystère.
Nous avons vu l’unité de l’Église se constituer autour de l’Eucharistie. Le Christ Jésus nous est apparu, au divin Sacrement, comme la pierre angulaire sur laquelle s’élève, dans l’agencement harmonieux de ses diverses parties, le temple saint formé de pierres vivantes à la gloire du Seigneur [68]. Pontife souverain établi pour les hommes, et l’un d’entre eux [69], il présente à Dieu l’hommage de ses frères, il offre au Père de tous le commun Sacrifice. Et si cet hommage du genre humain régénéré, si le Sacrifice, qui en est l’expression la plus haute, emprunte toute sa valeur à l’infinie dignité du Chef auguste donné à l’Église, il n’est complet cependant que par l’union des membres à leur Chef. La tête appelle le corps ; l’Église, nous dit l’Apôtre, est le complément du Christ et sa plénitude [70] ; elle parfait le Sacrifice, comme partie intégrante de la victime offerte sur l’autel. Ce qui est vrai de l’Église, l’est de chacun de nous qui sommes ses membres, si en effet nous sommes unis, dans l’Action du Sacrifice, de cette union intime qui fait des membres un même corps.
Telle est l’influence sociale de l’Eucharistie. Désagrégée par le péché, l’humanité retrouve dans le sang de l’Agneau son unité perdue. Ainsi Dieu rentre-t-il dans ses primitifs desseins sur le monde. L’homme était sorti du néant après toute créature, comme devant être l’organe de la louange universelle au nom de la création dont sa double nature offre le merveilleux résumé. L’homme relevé préside encore au concert des êtres : l’Eucharistie, l’Action de grâces, la louange par excellence, est le noble fruit de la race humaine. Chant sublime de la divine Sagesse au Roi des siècles, elle monte de cette terre, unissant l’ineffable harmonie du cantique éternel qui est le Verbe au sein du Père, et du cantique nouveau redit par le concert des mondes à la gloire de leur Auteur.
Les âges de foi avaient compris la merveilleuse grandeur du don fait par l’Homme-Dieu à son Église ; pénétrés de l’honneur qui en revient à notre terre, ils s’étaient crus dans l’obligation d’y répondre, au nom du monde entier, par la noblesse et la solennité des rites accompagnant la célébration du Mystère trois fois saint. La Liturgie était ce que l’indique son nom pour les chrétiens d’alors, la fonction publique, l’œuvre sociale entre toutes, appelant comme telle toutes les magnificences, et supposant la présence de la cité entière autour de l’autel. Sans doute, il serait facile de le prouver historiquement par les faits les mieux démontrés ; la croyance actuelle de l’Église catholique sur la légitimité des Messes privées fut celle de tous les siècles chrétiens dès l’origine. Pratiquement néanmoins et dans le cours ordinaire, la pompe des cérémonies, l’enthousiasme des chants, la splendeur des fonctions sacrées, semblèrent longtemps inséparables de l’oblation du Sacrifice.
Les solennités du culte divin dans nos cathédrales, aux plus beaux jours du Cycle, ne rappellent que de bien loin ces formes grandioses des antiques Liturgies dont nous retracions hier quelques traits incomplets. Si même l’Église, qui ne change pas dans ses aspirations, accuse hautement sa préférence pour les débris conservés des anciens jours, on ne peut nier toutefois qu’une impulsion très sentie n’incline aujourd’hui les peuples à délaisser toujours plus les pompes extérieures du Sacrifice, pour reporter sur un autre point les démonstrations de la piété chrétienne. Le culte de la divine présence eucharistique a pris des accroissements qui sont, en nos jours, la confusion de l’hérésie et la joie de tout catholique sincère ; mais il importe d’autant plus qu’un mouvement si profitable aux âmes, et si glorieux au divin Sacrement, ne soit pas retourné, par les ruses de l’ennemi, contre l’Eucharistie elle-même. Or, c’est ce qui arriverait aisément, si, par suite d’une dévotion mal pondérée, le Sacrifice, objet premier du dogme eucharistique, pouvait jamais déchoir en quelque manière dans la pensée intime ou la religion pratique des fidèles.
Un dogme ne saurait nuire à l’autre dans l’admirable enchaînement de la révélation chrétienne. Toute vérité nouvelle, ou présentée sous un nouveau jour, est un progrès dans l’Église et un gain pour ses enfants. Mais là seulement le progrès est réel dans l’application, où cette vérité mise en avant ne l’est pas de telle sorte qu’elle fasse rentrer dans l’ombre une vérité plus importante ; et jamais famille n’estimera comme un avantage le gain qui, pour se produire, entame le patrimoine des siècles. Principe évident par lui-même, et qu’il serait dangereux d’oublier dans l’étude comparative des différentes phases de l’histoire des sociétés humaines, et de l’Église en particulier. Si le divin Esprit, qui sans cesse la meut vers les hauteurs, pare sans repos l’Église pour les noces éternelles et illumine à chaque pas son front d’une lumière plus rayonnante, trop souvent aussi l’élément humain dont elle est pétrie dans ses membres fait sentir son poids à l’Épouse. Il arrive alors que, dans sa sollicitude maternelle pour des enfants maladifs qui n’ont plus la force de se soutenir dans les régions élevées et la forte atmosphère où vécurent leurs aînés, sans cesser de monter par ses aspirations et de grandir dans les cieux, elle décline des voies qu’elle aimait à suivre plus près de l’Époux sur les montagnes, aux beaux temps de son histoire ; elle descend vers ceux qu’elle veut sauver, s’amoindrit en apparence et se fait à leur taille. Ineffable condescendance, mais qui ne donne nullement aux fils de ces générations amoindries le droit de se préférer à leurs devanciers ! Le malade l’emporte-t-il donc sur l’homme en santé, par la raison que la nourriture indispensable au reste de vie qui végète en sa personne se présente à lui sous des formes nouvelles et mises à la portée de ses organes débilités ?
Pour avoir vu donner de nos jours, sous un mode plus nouveau, certain essor à la dévotion de quelques âmes envers l’hôte divin des tabernacles, une affirmation s’est produite, attestant que « jamais les siècles passés n’ont égalé le nôtre dans le culte du Très Saint Sacrement » ; et, sur ce témoignage d’un pieux enthousiasme, le dix-neuvième siècle, dont l’incessante fécondité se vante à juste titre d’avoir ouvert tant d’aspects nouveaux de toute sorte au champ de la piété, s’est laissé modestement nommer quelque part le « grand siècle de l’Eucharistie ». Plût au ciel que cette appellation fût justifiée ! Car il est très vrai « qu’un siècle grandit ou décroît en raison de son culte pour la divine Eucharistie » : c’est le témoignage de l’histoire. Mais il n’est pas moins assuré qu’en un pareil rapprochement des siècles au point de vue du Sacrement d’amour qui est l’incessante vie de l’Église, on devra regarder comme la grande époque celle où les intentions du Seigneur dans l’auguste Mystère se trouveront être plus parfaitement comprises et mieux remplies, non celle où la piété privée se donne plus largement carrière [71].
Or, sans nous attacher en ce moment au développement de considérations dogmatiques qui trouveront mieux leur place dans quelques jours, l’histoire est encore là pour attester que l’Église, interprète fidèle et sûre des pensées de l’Époux, a maintenu la discipline eucharistique des premiers âges, tant qu’ont duré dans leur éclat la ferveur et la foi des nations occidentales. Alors que, successivement victorieuse des persécutions païennes et du dogmatisme obstiné des Césars de Byzance, plus libre qu’elle ne le fut jamais et sûre d’être obéie, elle dirigeait le monde en souveraine, la noble dépositaire du Testament nouveau persévéra dans la voie qu’avaient suivie les Martyrs et justifiée les Pères dans leurs écrits : elle continua d’absorber dans le Sacrifice, dans les pieuses fatigues de la Messe solennelle et des Heures canoniales qui ne sont que le rayonnement naturel du Sacrifice, les forces vives des nouveaux enfants que lui donnait la conversion des Barbares.
Rien de plus catholique, rien de moins individuel et de moins privé, dans ces temps, que le culte eucharistique ainsi basé sur la notion sociale du Sacrifice. Cette notion restait présente à la pensée de ceux mêmes que la maladie ou des circonstances particulières contraignaient de communier séparément à la Victime universelle. Elle suffisait à diriger sûrement les cœurs et les adorations vers la colombe d’or ou la tour d’ivoire où se conservaient, dans l’ineffable intégrité du Sacrement, les restes précieux du Sacrifice.
La foi, une foi non moins vive et profonde que de nos jours à la présence réelle, animait la Liturgie entière, et soutenait tout ce vaste ensemble de rites et de cérémonies inexplicables en dehors du dogme catholique. Maintenu par tous au-dessus de la discussion, ce dogme si cher était à la fois la pierre fondamentale et la ferme charpente de l’édifice élevé par l’éternelle Sagesse au milieu des hommes. Il peut sembler qu’on s’en occupât alors moins spécialement que de nos jours ; mais ne serait-ce point que, d’ordinaire, le rocher portant l’édifice et la charpente la plus merveilleuse appellent moins de sollicitude en un palais non éprouvé encore par l’insouciance des habitants ou les assauts de l’ennemi ?
Si l’Église, quant à elle, ne saurait défaillir, c’est la loi de l’histoire que dans son sein même, et malgré la vitalité qu’elle donne aux nations, une société ne se maintient jamais longtemps aux sommets de perfection qu’elle peut atteindre. Les peuples sont comme les astres, dont l’apogée marque fatalement l’heure du déclin : ils paraissent ne s’élever, que pour bientôt décroître et végéter dans l’impuissance du vieillard épuisé par les ans. Ainsi en devait-il être de la chrétienté elle-même, cette grande confédération des peuples établie par l’Église dans la forte unité d’une charité non feinte et d’une foi sans mélange. C’est à l’heure même où l’immense impulsion des croisades, soulevant une seconde fois le monde à la voix de saint Bernard, semble marquer pour plusieurs le point culminant du règne du Christ et consacrer à jamais la puissance de l’Église, que reparaissent et s’accentuent les signes d’une décadence, suspendue jusque-là par l’héroïque génie de saint Grégoire VII, mais qui ne s’arrêtera plus désormais jusqu’à la grande défection du XVIe siècle et l’apostasie générale des sociétés modernes.
La grande moniale du moyen âge, Hildegarde, scrutait alors de son œil d’aigle les misères du présent et les profondeurs plus noires encore de l’avenir. De cette plume qui transmettait les oracles divins aux pontifes et aux rois, elle écrivait :
« L’an de l’Incarnation du Seigneur mil cent soixante-dix, éveillée de corps et d’âme, je vis une très belle image de femme, si parfaite dans la suavité de ses attraits et si pleine de délices, que l’esprit humain ne saurait comprendre sa beauté. Sa taille allait de la terre au ciel. Sa face rayonnait de lumière, et son œil pénétrait les cieux. Elle était vêtue d’une robe éclatante de soie blanche ; un manteau chargé des pierres les plus précieuses entourait son corps, et elle avait aux pieds des chaussures d’onyx. Mais le visage était couvert de poussière, la robe déchirée au côté droit ; le manteau et la chaussure avaient perdu l’éclat de leur ancienne beauté. Et elle criait d’une voix puissante et lamentable dans les hauteurs des cieux : Entends, ciel, que ma face est souillée ; terre, gémis de ce que ma robe est lacérée ; abîme, tremble à la vue de mes chaussures noircies. Les renards ont leurs tanières, et les oiseaux du ciel leurs nids [72] ; et je n’ai, moi, ni aide, ni consolateur, ni bâton pour m’appuyer et soutenir mes pas... Ils m’ont couverte d’opprobres et délaissée, ceux qui devaient me parer en toutes manières. Car c’est eux-mêmes qui maculent mon visage, en traînant le corps et le sang de mon Époux dans l’abominable impureté de leurs mœurs et la fange immonde de leurs fornications et de leurs adultères, achetant et vendant par une insatiable avarice les choses saintes, pour les souiller ainsi qu’un enfant jeté aux pourceaux dans leur fange. Les plaies toujours béantes du Christ mon Époux sont vilipendées sur les autels...
C’est pourquoi, ô prêtres, un temps viendra que les princes et les peuples se rueront contre vous ; ils dépouilleront ces prévaricateurs du sacerdoce, et ils diront : Chassons de l’Église ces adultères, ces ravisseurs, ces réservoirs du crime. Et en cela ils prétendront servir Dieu dont vous souillez l’Église. Oui, par la permission divine, contre vous dans leurs conseils frémiront des nations nombreuses, et les peuples ourdiront contre vous des complots, n’estimant pour rien votre sacerdoce et la consécration de vos mains. Aux complots de leurs peuples assisteront les rois, dévorant des yeux vos richesses. Et tous n’auront qu’un seul dessein : vous chasser de leurs terres, parce que l’iniquité de vos œuvres a chassé de vous l’innocent Agneau.
Et j’entendis une voix du ciel qui disait : Cette image est l’Église » [73].
Tableau inspiré, rendant en traits de feu, jusqu’en ses lointaines conséquences, la situation faite à l’Église au XIIe siècle ! Situation intimement liée, comme il convient, aux destinées du Mystère de l’autel. Les désordres du sanctuaire amenaient forcément le relâchement des peuples. On les vit se dégoûter du mets céleste présente par des mains trop souvent souillées ; les convives se tirent rares au banquet de la divine Sagesse, .et l’abandon devint si prononcé, qu’en 1215, un concile œcuménique, le IVe de Latran, porta la loi bien connue contraignant, sous les peines les plus sévères, tout fidèle de l’un ou l’autre sexe à communier au moins une fois dans l’année. Si grand était le mal, que les prescriptions des conciles et le génie d’Innocent III, le dernier des grands papes du moyen âge, n’eussent pu suffire à le conjurer, si Dieu n’avait donné saint Dominique et saint François à son Église : ils relevèrent l’honneur du sacerdoce, et ranimèrent pour un temps la piété des peuples. Mais les antiques formes liturgiques avaient sombré dans la crise.
L’oblation commune, qui supposait la communion de tous à l’auguste Victime, avait cédé la place aux fondations privées et aux honoraires ou stipendium dont l’usage ne fit que s’accroître à l’arrivée des Ordres mendiants. L’Église renonçait à l’espoir de ramener le peuple chrétien, comme corps social, aux formes anciennes ; elle toléra d’abord, et encouragea bientôt l’initiative individuelle qui s’assurait ainsi dans le Sacrifice une part déterminée, en subvenant aux besoins des sacrificateurs. Les Messes privées, à intentions spéciales, se multiplièrent donc pour satisfaire aux obligations contractées envers les particuliers. Mais par une suite nécessaire, le rite imposant de la concélébration, maintenu à Rome jusqu’au XIIIe siècle, finit par disparaître à peu près entièrement d’Occident. Le Sacrifice ne se présentait plus dès lors avec ces allures majestueuses qui lui assuraient, aux yeux des générations antérieures, une prépondérance incontestée dominant la religion entière et toute la vie chrétienne.
Bientôt, perdant de vue la connexion intime et la mutuelle dépendance du Sacrifice et du Sacrement dans le Mystère d’amour, on commença, dans certains lieux, à distribuer sans trop de scrupule la très sainte Eucharistie en dehors de la Messe, pour des raisons peu sérieuses. Et plus d’un docteur scolastique aidant au mouvement, à l’insu de la vraie science, par ses habitudes de définitions tranchantes et de division catégorique, la communion sembla devenir dans l’esprit de plusieurs comme une section à part de l’institution eucharistique. Prélude de ces communions isolées et furtives par système, dont quelques-uns font aujourd’hui l’idéal d’une spiritualité pieusement ennemie de la foule et du bruit des pompes extérieures !
La notion du Sacrifice, qui renferme le motif principal de la présence du Verbe incarné dans l’Eucharistie, ne frappait donc plus tout d’abord comme autrefois l’esprit des peuples. Il arriva que, par contre, l’idée de cette présence d’un Dieu sous les espèces eucharistiques s’empara des âmes d’une manière plus exclusive, d’autant plus vive et plus dominante. Ce fut alors que dans l’esprit d’une sainte frayeur, et sous l’impulsion d’un respect qui ne saurait être en effet trop profond, on acheva d’abandonner plusieurs anciens usages : établis à l’origine dans la pensée d’étendre ou de mieux exprimer l’application du Sacrifice, ils furent supprimés comme pouvant exposer involontairement les saintes espèces à quelque irrévérence. Ainsi tombèrent en désuétude l’usage du calice pour les simples fidèles et la communion des enfants en bas âge.
Une immense révolution rituelle s’était donc accomplie. L’Église, qui ne pouvait y voir, en plus d’un point, qu’un amoindrissement du passé, l’accepta cependant. Le temps était venu où les grandes formes sociales de la Liturgie, appelant pour base la puissante unité des nations chrétiennes, n’eussent plus été que des formes menteuses. La défiance des États contre l’Église, leur seul lien réciproque, s’accentuait tous les jours, n’attendant que l’occasion de se déclarer en hostilité ouverte. Les légistes étaient à l’œuvre, et bientôt les exploits de Pierre Flotte et de Guillaume de Nogaret allaient montrer au monde combien était actif le travail de dissolution remis à leurs soins.
Si le mal était grand dans la place, plus grands encore étaient les dangers que les assauts de l’hérésie faisaient courir du dehors au peuple fidèle. Mais c’est ici qu’apparaît la prudence divine qui conduit l’Église. Pour défendre la foi, qui est l’élément essentiel de son existence ici-bas, elle se fit un rempart des ruines mêmes accumulées par cette révolution liturgique qu’elle avait dû subir : sanctionnant de son autorité ce qui pouvait l’être, elle enraya le mouvement ; et, mettant à profit la préoccupation plus marquée que ce mouvement amenait dans les âmes au sujet de la divine présence eucharistique, elle fit entrer la Liturgie dans une voie nouvelle, où l’incessante affirmation du dogme allait remplacer les formes moins précises, quoique non moins complètes et beaucoup plus grandioses du premier âge. C’était répondre à l’hérésie d’une manière d’autant plus forte qu’elle serait plus directe. Nous avons vu comment, par suite de ses attaques encore détournées, s’imposait de plus en plus, au XIIIe siècle, la convenance souveraine d’une fête spéciale, consacrée à honorer comme tel le Mystère de la foi. Elle devint une nécessité à l’approche, prévue par Dieu seul encore, des audaces triomphantes de l’hérésie sacramentaire. Il fallait prévenir l’attaque, et faire en sorte par avance que ces assauts fussent en leur temps moins dangereux pour les chrétiens, et moins préjudiciables au Seigneur lui-même dans son Sacrement. Le moyen d’atteindre plus efficacement ce double but était le développement de la dévotion extérieure à la présence réelle : par là, l’Église se manifestait en possession du dogme, et le Sacrement d’amour trouverait compensation à l’abandon de plusieurs dans la ferveur renouvelée des âmes restées fidèles.
Établie dans le monde entier par l’autorité des Pontifes romains, la fête du Très Saint Sacrement ou du Corps du Seigneur fut donc, en elle-même et dans ses développements, ainsi que nous le disions avant-hier, le point de départ d’une nouvelle phase pour le culte catholique envers la divine Eucharistie. A sa suite, Processions, Saluts, Quarante-Heures, Expositions, Adorations, sont venus protester toujours plus de la foi de l’Église en la présence réelle, réchauffer dans les peuples une piété détaillante, et rendre au Dieu résidant pour nous sous les espèces sacramentelles les hommages qu’il est en droit d’y attendre.
Église, ils ne sont plus ces temps où vous retraciez ici-bas l’image de la céleste Jérusalem, alors que, dans toute la liberté des inspirations de votre cœur d’Épouse, nos pères vous contemplaient ordonnant le Sacrifice auguste avec cette majesté sublime qui leur en faisait pénétrer les grandeurs. Nous ne voyons plus ces royales magnificences, qu’un monde amoindri ne saurait porter. Les nations insensées dont vous faisiez la gloire en les rassemblant dans l’unité des sacrés Mystères, ont fait alliance, pour leur malheur, avec l’ancien ennemi. Lorsque sans nulle crainte, forte de la conscience de vos droits et de vos bienfaits, vous cultiviez dans la paix le jardin de l’Époux, jouissant des suaves parfums qu’il exhalait au ciel et des fruits de la vigne mystique, un bruit insolite a retenti, le bruit des chars d’Aminadab lancés par des mains perfides [74]. Vous n’eussiez été que juste, ô Église, laissant dès lors cette terre ingrate, et fuyant vers l’Époux dans les célestes hauteurs Mais plus que jamais étrangère en la terre de votre exil, ô Sulamite, vous avez entendu dans les siècles à venir les cris de ceux que vous pouviez sauver encore ; et vous êtes restée dans votre dévouement, ô notre Mère, vous êtes restée pour que vos fils du dernier âge pussent eux aussi, comme leurs aînés, puiser dans vos yeux la lumière et la vie.
Nous ne l’ignorons pas : au lieu des pacifiques splendeurs que déployait la reine dans l’éclat d’une souveraineté incontestée, au lieu des chœurs d’exultation et de triomphe conduits par l’Épouse en ses palais, nous ne verrons plus dans la Sulamite que des marches guerrières et le chant des combats [75]. Mais qu’ils sont beaux toujours vos pas dans les chaussures de votre pèlerinage, ô fille du Roi, terrible désormais comme une armée rangée en bataille ! Que vous êtes belle, déposant la robe d’or et la variété des ornements qui vous entouraient sur le trône à la droite du Prince, pour ceindre avec lui l’épée puissante et percer de vos flèches acérées les cœurs des ennemis [76] !
Que l’Église grecque, immobilisée dans la fatale stérilité de la branche séparée du tronc, garde, feuillage desséché, ces antiques formes dont l’imposante unité n’a plus chez elle que le schisme pour base ! L’hérésie, étalant sous les voûtes des cathédrales bâties par nos pères les rites abâtardis de sa cène mesquine, est-elle donc plus étrange que ce schisme décrépit gardant fièrement des formes qui le condamnent, et faisant parade d’ornements qui ne sont plus à sa taille ? Quelle vie puiseront jamais ses membres dans le vide de ces formes incomprises ?
Celle-là seule est la Mère qui sait parler aux fils leur langage, et ne donne pas aux malades appauvris la nourriture des forts ; celle-là seule est l’Épouse, qui sait être ingénieuse à faire valoir toujours au taux le plus élevé selon les temps le trésor de l’Époux, la perle incomparable, modifiant, s’il le faut, ses plus chères habitudes, ses plus légitimes aspirations, sachant enfin quitter les délices du trône et ses grandeurs pour marcher à l’ennemi.
Nous vous reconnaissons à ce signe, ô Épouse, ô Mère, qui bégayez avec les petits comme vous chantiez avec les forts, qui terrassez l’ennemi dans la vigueur de votre bras là même où vous sembliez ne penser qu’à jouir de l’Époux. Au prix d’une lutte continuelle et de labeurs incessants, chaque jour plus méconnue d’une foule toujours croissante de fils ingrats, vous restez avec nous : vous restez pour porter au dernier des élus l’Hostie sainte qui doit l’associer au grand Sacrifice. Nous vous suivrons, ô notre Mère, dans votre marche militante à travers les détours delà route escarpée qui vous conduit au but ; nous vous suivrons, parce que vous portez avec vous le trésor du monde. Plus audacieuses se feront les attaques de l’hérésie, plus outrageants les blasphèmes des fils ingrats : plus éclatantes seront en retour les affirmations de notre foi, plus profondes nos adorations, plus chaleureuses et plus vives les démonstrations de notre amour envers l’Hostie sainte.
En ce jour de préparation, nous emprunterons la formule de nos vœux au Missel gothique d’Espagne. La solennité du Corps du Seigneur étant d’institution relativement récente, les Mozarabes ont composé cette Préface, qui est celle du jour même de la fête, avec une partie de l’Illation assignée au Mercredi de la troisième semaine de Carême. Il sera facile d’en remarquer la trace, à la mention du jeune qui s’y trouve exprimée, bien que ce jeûne puisse s’entendre aussi des privations de tout genre dont la vie est pleine.
| ILLATION. | |
| Dignum et justum est nos tibi gratias agere, Domine sancte, Pater æterne, omnipotens Deus. Qui paras adinventiones tuas sapienter : et disponis omnia suaviter. Qui ascendisti super occasum : Dominus nomen est tibi. Tu panis es vivus et verus : qui descendisti de cœlo ut dares escam esurientibus, imo ut ipse esses esca viventium. Qui es nobis in pane quo corda firmantur : ut in virtute panis hujus, per hos dedicatos Nomini tuo dies, sine impedimento carnis et sanguinis jejunare valeamus, te ipsum panem habentes. Quia pauperes tuos cœlestibus saturas panibus. | Il est digne et juste que nous vous rendions grâces, Seigneur saint, Père éternel, Dieu tout-puissant, qui préparez vos œuvres dans la sagesse et disposez toutes choses avec suavité, qui êtes monté vers l’Occident et avez pour nom le Seigneur. Vous êtes le pain vivant et véritable ; vous êtes descendu des cieux pour nourrir ceux qui ont faim, bien plus pour être vous-même la nourriture des vivants : pain où nos cœurs puisent leur force, pain dont la vertu remplit ces jours consacrés à votre Nom. La chair et le sang ne peuvent troubler nos jeûnes, lorsque notre pain c’est vous-même. Ainsi rassasiez-vous vos pauvres des pains du ciel. |
Les premières Vêpres.
Nous touchons enfin au grand jour qui, depuis Lundi, tient nos âmes dans le recueillement et l’attente. La terre se dispose à reconnaître, dans l’hommage d’un solennel triomphe, le Christ pontife et roi présent dans l’Hostie. Le triste privilège qui retient, pour trois jours encore, la France à l’écart des saints transports de la catholicité, ne peut nous empêcher d’unir dès maintenant notre allégresse et nos adorations aux hommages de l’Église envers le divin Sacrement. Partout les pieux fidèles apportent leur concours aux préparatifs du triomphe qui attend demain l’Hostie sainte. Durant ces apprêts qu’inspirent la foi et l’amour, l’Église prélude dans ses temples à la grande fête par la solennité des premières Vêpres. Accordant sa lyre aux sublimes Antiennes du Docteur angélique, elle célèbre, dans un chant majestueux comme les paroles, le Pontife éternel selon l’ordre de Melchisédech, et le divin banquet réunissant comme de jeunes plants d’olivier les fils de l’Église autour de la table du Seigneur.
Les bornes qui s’imposent à nous dans cet ouvrage sembleraient devoir en exclure les parties de l’Office auxquelles n’assistent pas généralement les fidèles ; c’est la pratique que nous avons suivie jusqu’ici. Mais la célébrité si justement acquise à l’œuvre de saint Thomas pourrait faire regretter à plusieurs de ne la rencontrer ici que tronquée. La magnificence des Hymnes et des Psaumes, des Antiennes et des Répons, tout cet ensemble si plein de la vraie sève catholique, fournira d’ailleurs aux fidèles le meilleur thème de contemplation qui puisse éclairer leurs intelligences et échauffer leurs cœurs durant toute cette Octave. Chaque jour de cette semaine les doit voir saintement empressés aux pieds du Roi de gloire qui tiendra sa cour au milieu de son peuple, ne se dérobant à leurs yeux de chair que sous le nuage léger des espèces sacramentelles. Durant les heures fortunées qu’un industrieux amour saura dérober ainsi aux occupations ordinaires, qu’ils choisissent donc de préférence l’expression de leurs sentiments dans les formules consacrées par l’Église elle-même à chanter l’Époux en son divin banquet ; non seulement ils y trouveront la poésie, la doctrine et la grâce, habituelle parure de l’Épouse en présence du Bien-Aimé, mais ils auront fait vite aussi l’heureuse expérience que, comme le mets céleste lui-même, ces formules sanctifiées se prêtent à toutes les âmes ; s’adaptant aux dispositions et degrés divers d’avancement spirituel, elles deviennent en chaque bouche l’expression la plus opportune et la plus vive des besoins et désirs de tous.
Les premières Vêpres de la fête du Très Saint Sacrement sont en tout semblables aux secondes Vêpres, à l’exception de l’Antienne de Magnificat. L’Église célèbre en cette Antienne la suavité du Seigneur manifestée par celle du pain eucharistique ; mais ceux-là seuls en goûtent la douceur et en recueillent les fruits de salut, qui sont conduits au divin banquet parla faim spirituelle d’un humble et ardent désir. Dans ces sentiments, avec la Vierge immaculée, glorifions le Seigneur qui exalte les humbles et confond les puissants. C’est à la plus humble des filles d’Adam que nous devons le Pain céleste : il fut façonné par l’Esprit dans ses chastes entrailles. Nous aurons occasion de le redire. Mais, dès maintenant, n’oublions plus que la fête du Corps du Seigneur nous ramène à Marie dans nos hommages reconnaissants.
L’Octave du Très Saint Sacrement ne le cède, en privilèges, qu’à celles de l’Épiphanie, de Pâques et de la Pentecôte. Elle n’admet pas de fêtes transférées au-dessous du rite double de première ou de seconde classe ; et les fêtes semi-doubles, qui se rencontrent au Calendrier durant ces huit jours, n’obtiennent qu’une simple mémoire. Dans les fêtes doubles elles-mêmes, qu’on y célèbre à leurs jours, on n’omet jamais, quel qu’en soit le degré, la mémoire du Très Saint Sacrement à la Messe, à Laudes et à Vêpres ; et la solennité du Corps du Seigneur ne laisse pas de marquer aussi son empreinte à toutes les Hymnes dont la mesure le permet, par la doxologie suivante, qui est celle de Compiles et des Petites Heures dans l’Office de demain.
Touchant hommage rendu à la Vierge-mère que cette exaltation réitérée de sa fécondité virginale en la fête de l’Eucharistie ! L’Église s’est souvenue que « le premier blasphème contre la vérité du sacrement de l’autel consistait à nier que le corps eucharistique du Seigneur fût le corps né de Marie » [77]. Et voyant comment, depuis, les adversaires du Fils dans son Mystère d’amour ont toujours aussi méconnu la Mère, elle les unit comme le firent les Ignace et les Irénée, vaillants témoins de la foi primitive, dans une même formule de confession et de louange en face de l’Hostie sainte. Il a pris chair de la chair de Marie, dit saint Augustin ; et c’est cette chair, devenue la sienne, qu’il nous donne à manger comme l’aliment du salut, et que nous adorons auparavant comme l’escabeau de ses pieds dans le psaume » [78].
La couleur blanche employée par l’Église en cette Octave demeure, dans tout le cours de l’année, la couleur propre au divin Sacrement. Elle rappelle elle-même les doux rapports des mystères de Noël et de l’Eucharistie, non moins que la divine pureté du froment des élus qui donne à l’homme le pain des Anges [79], et fait ici-bas germer les vierges [80].
A cette heure où déjà l’Église acclame le divin Sacrement, saluons dans ces pensées l’Hostie qui bientôt va paraître. La formule suivante, usitée depuis le XIVe siècle dans les Églises de France et d’Allemagne, terminera dignement cette journée comme l’annonce prochaine du glorieux Mystère. Elle se chantait dans l’origine au moment de l’élévation, et s’alliait au trisagion qu’elle complétait, comme l’indiquent ces mots in excelsis, les derniers du Sanctus, qui la terminent sur les meilleurs manuscrits. C’était ce genre de compositions appelées Tropes, qui furent chères à la piété du moyen âge, et d’où sont dérivées nos Proses ou Séquences.
| IN ELEVATIONE CORPORIS CHRISTI. | |
| Ave verum Corpus natum de Maria virgine : | Salut, vrai Corps né de la Vierge Marie, |
| Vere passum, immolatum in cruce pro homine : | Vraiment passé par la souffrance, immolé sur la croix pour l’homme. |
| Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine. | Dont le côté ouvert a répandu le sang et l’eau : |
| Esto nobis prægustatum mortis in examine, | Soyez pour nous l’avant-goût du ciel aux approches de la terrible mort, |
| O Jesu dulcis ! | O doux Jésus ! |
| O Jesu pie ! | O bon Jésus ! |
| O Jesu Fili Mariæ ! | O Jésus, Fils de Marie ! |

La Fête du Saint-Sacrement.
Une grande solennité s’est levée sur le monde : la Fête-Dieu, ainsi l’ont appelée nos pères ; vraiment fête de Dieu, mais aussi fête de l’homme, étant la fête du Christ-médiateur présent dans l’Hostie pour donner Dieu à l’homme et l’homme à Dieu. L’union divine est l’aspiration de l’humanité [81] ; à cette aspiration, ici-bas même, Dieu a répondu par une invention du ciel. L’homme célèbre aujourd’hui cette divine merveille.
Contre cette fête toutefois et son divin objet, des hommes ont répété la parole déjà vieille : Comment ces choses peuvent-elles se faire [82] ? Et la raison semblait justifier leurs dires contre ce qu’ils appelaient les prétentions insensées du cœur de l’homme. Tout être a soif de bonheur, et cependant, et pour cela même, n’aspire qu’au bien dont il est susceptible ; car c’est la condition du bonheur de ne se rencontrer que dans la pleine satisfaction du désir qui le poursuit. De là vient qu’au commencement, la divine Sagesse préparant les cieux, creusant les abîmes, équilibrant la terre et composant toutes choses avec la Toute-Puissance [83], distribua inégalement la lumière et la vie dans ce vaste univers, et mesura ses dons aux destinées diverses ; plaçant l’harmonie du monde dans ce rapport parfait des divers degrés d’être avec les fins variées des créatures, sa bonté prévoyante adapta les besoins, l’instinct, le désir de chacune à leur nature propre, et n’ouvrit pas en elles des aspirations que celle-ci ne saurait satisfaire. La poursuite du bien et du beau, la recherche de Dieu, loi impérieuse de toute nature intelligente et libre, ne doit-elle pas s’arrêter en conséquence, elle aussi, aux proportions finies de cette nature même ? N’arriverait-il pas autrement que le bonheur fût placé, pour quelques êtres, en des jouissances que leurs facultés créées ne peuvent atteindre ?
Quelque étrange que puisse paraître une telle anomalie, elle existe pourtant : l’humanité, dans tous les âges, par ses tendances les plus universelles, les mieux constatées, par toutes ses religions vraies ou fausses, en rend témoignage. Comme tout ce qui vit autour de lui, l’homme a soif de bonheur ; et cependant, seul sur cette terre, il sent en lui des aspirations qui dépassent immensément les bornes de sa fragile nature. Tandis que, docilement rangés sous le sceptre remis en ses mains par l’Auteur du monde, les humbles hôtes de sa royale demeure accomplissent dans la pleine satisfaction de tout désir rempli leurs services divers, le roi de la création ne peut trouver dans le monde de contrepoids à l’irrésistible impulsion qui l’entraîne au delà des frontières de son empire et du temps, vers l’infini. Dieu même se révélant à lui, par ses œuvres, d’une façon correspondante à sa nature créée ; Dieu cause première et fin universelle, perfection sans limites, beauté infinie, bonté souveraine, objet bien digne de fixera jamais en les comblant son intelligence et son cœur : Dieu ainsi connu, ainsi goûté, ne suffit pas à l’homme. Cet être de néant veut l’infini dans sa substance ; il soupire après la face du Seigneur et sa vie intime. La terre n’est à ses yeux qu’un désert sans issue, sans eau pour étancher sa soif brûlante ; dès l’aurore, son âme veille, affamée du Dieu qui peut seul calmer ces ardeurs, et sa chair même éprouve vers lui d’ineffables tressaillements [84]. « Comme le cerf, s’écrie-t-il, aspire après l’eau des fontaines, ainsi mon âme aspire a. après vous, ô Dieu ! Mon âme a soif du Dieu fort, du Dieu vivant. Oh ! Quand viendrai-je, quand paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont devenues mon pain du jour et de la nuit ; on médit tous les jours : Où est ton Dieu ? J’ai repassé leurs injures, j’ai répandu mon âme au dedans de moi-même. Mais je passerai jusqu’au lieu du tabernacle admirable, jusqu’à la maison de Dieu. Voix d’allégresse et de louange ! C’est l’écho du festin. Pourquoi es-tu triste, mon âme ? Pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu, parce que je le louerai encore : il est le salut que verra mon visage, il est mon Dieu » [85].
Enthousiasme étrange assurément pour la froide raison ; prétentions, semble-t-il, vraiment insensées ! Cette vue de Dieu, cette vie divine, ce festin dont Dieu même serait l’aliment, l’homme fera-t-il jamais que ces sublimités ne demeurent infiniment au-dessus des puissances de sa nature, comme de toute nature créée ? Un abîme le sépare de l’objet qui l’enchante, abîme qui n’est autre que l’effrayante disproportion du néant à l’être. L’acte créateur dans sa toute-puissance ne saurait à lui seul combler l’abîme ; et pour que la disproportion cessât d’être un obstacle à l’union ambitionnée, il faudrait que Dieu même franchît la distance et daignât communiquer à ce rejeton du néant ses propres énergies. Mais qu’est donc l’homme, pour que l’Être souverain dont la magnificence est au-dessus des cieux abaisse jusqu’à lui leurs hauteurs [86] ?
Mais alors aussi, qui donc a fait du cœur humain ce gouffre béant que rien ne saurait remplir ? Lorsque les cieux racontent la gloire de Dieu, et les œuvres de ses mains la sagesse et la puissance de leur auteur [87], d’où vient en l’homme un tel manque d’équilibre ? Le poids, le nombre et la mesure [88] auraient-ils fait défaut pour lui seul au suprême ordonnateur ? Et celui qui devait être le chef-d’œuvre de la création, comme il en est le couronnement et le roi, ne serait-il qu’une de ces œuvres manquées accusant par leur défaut de proportions la lassitude ou l’impuissance de l’ouvrier ? Loin de nous un tel blasphème ! Dieu est amour » [89], nous dit saint Jean ; et l’amour est le nœud du problème qui se dresse, aussi insoluble qu’inévitable, en face de la philosophie réduite à ses seules forces.
Dieu est amour ; et la merveille n’est pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu’il nous ait lui-même prévenus d’amour [90]. Mais l’amour appelle l’union, et l’union veut des semblables. O richesses de la divine nature en laquelle s’épanouissent, également infinis, Puissance, Sagesse et Amour, constituant dans leurs sublimes relations la Trinité auguste qui, depuis Dimanche, darde sur nous ses feux ! O profondeurs des divins conseils, où ce que veut l’Amour sans bornes trouve en la Sagesse infinie de sublimes expédients qui font la gloire de la Toute-Puissance !
Gloire à vous tout d’abord, Esprit-Saint, dont le règne à peine commencé illumine de tels rayons nos yeux mortels, qu’ils analysent ainsi les éternels décrets ! Au jour de votre Pentecôte, une loi nouvelle, toute de clartés, a remplacé l’ancienne et ses ombres. La loi du Sinaï, le pédagogue qui préparait à la vraie science et régissait l’enfance du monde, a reçu nos adieux : la lumière a brillé par la prédication des saints Apôtres ; et les fils de lumière, émancipés, connaissant Dieu, connus de lui, s’éloignent toujours plus chaque jour des maigres et infirmes éléments du premier âge [91]. A peine s’achevait, Esprit divin, la triomphante Octave où l’Église célébrait avec votre avènement sa propre naissance : et déjà, empressé pour la mission reçue par vous de rappeler à l’Épouse les leçons du Seigneur [92], vous présentiez aux regards de sa foi le sublime et radieux triangle dont la contemplation ravit nos âmes éperdues dans l’adoration et la louange. Mais le premier des grands mystères de notre foi, le dogme sans fond de la très sainte Trinité, ne représentait pas l’économie entière de la révélation chrétienne ; vous aviez hâte d’étendre, avec le champ de vos enseignements, les horizons de la foi des peuples.
La connaissance de Dieu en lui-même et dans sa vie intime appelait comme complément celle de ses œuvres extérieures, et des rapports qu’il a voulu établir entre lui et ses créatures. Et voilà qu’en cette semaine qui nous voit commencer avec vous l’ineffable inventaire des dons précieux laissés en nos mains par l’Époux montant au ciel [93], en ce premier jeudi qui nous rappelle le jeudi, saint entre tous, de la Cène du Seigneur, vous découvrez à nos cœurs tout à la fois la plénitude, le but, l’admirable harmonie des œuvres qu’opère le Dieu un dans son essence et trois dans ses personnes ; sous le voile des espèces sacrées, vous offrez à nos yeux, monument divin, le mémorial vivant des merveilles accomplies par le concert de la Toute-Puissance, de la Sagesse et de l’Amour [94] !
L’Eucharistie pouvait seule, en effet, mettre en pleine lumière le développement dans le temps, la marche progressive des divines résolutions inspirées par l’amour infini qui les conduit jusqu’à la fin [95], jusqu’au dernier terme ici-bas qui est elle-même ; couronnement de l’ordre surnaturel en cette terre de l’exil, elle explique et suppose tous les actes divins antérieurs. Nous ne saurions donc pénétrer sa divine importance, qu’en embrassant d’un, même regard les opérations de l’amour infini dont elle est sur terre le sommet glorieux. Ainsi, en même temps, trouverons-nous le secret de ces aspirations supérieures à la nature qui donnent à l’histoire de l’humanité, jusqu’en ses égarements, tant de grandeur mystérieuse ; ainsi verrons-nous que celui-là seul a creusé l’abîme du cœur humain, qui peut et veut le combler.
Tout acte de la divine volonté, hors de Dieu comme en lui-même, est amour pur, se rapportant à la troisième des augustes personnes, qui est, par le mode de sa procession, l’Amour substantiel et infini. De même que le Père tout-puissant voit toutes choses, avant qu’elles existent, en son Verbe unique, en qui s’épuise la divine intelligence : de même, pour qu’elles soient, il les veut toutes dans l’Esprit-Saint, qui est à la divine volonté ce qu’est le Verbe à l’intelligence souveraine. Terme dernier auquel s’arrête l’intime fécondité des personnes, en la divine essence, l’Esprit d’amour est en Dieu le principe premier des œuvres extérieures : communes dans l’exécution aux trois personnes, elles ont en lui leur raison d’être. Ineffable solliciteur, il incline la Divinité en dehors d’elle-même ; il est le poids qui, rompant les éternelles barrières, plus violent que la foudre [96], entraîne des sommets de l’être aux confins du néant la Trinité auguste. Ouvrant le grand conseil, il y dit la parole : « Faisons l’homme à notre image et ressemblance » [97]. Et Dieu crée l’homme à son image ; il le crée à l’image de Dieu [98], copiant son Verbe, l’archétype souverain, dans lequel toute création plonge ses racines comme dans le lieu des essences. Car le Verbe, pensée du Père, miroir très pur [99] de l’intelligence infinie, renferme en soi l’idée divine de toute chose : règle des mondes, exemplaire éternel, lumière vivante et vivifiante [100] qui donne leur forme et leur nature à tous les êtres. Mais dans l’homme seul, résumé des mondes, à la fois esprit et matière, se retrouvera l’expression complète de la pensée créatrice. L’âme même, en lui, portera directement l’image de la divine ressemblance [101], dont ce même Verbe est l’expression substantielle et infinie [102] : doué d’intelligence et de liberté comme l’Être souverain, il animera pour Dieu la création entière ; elle remontera par lui vers son Auteur dans un hommage, borné sans doute, mais en rapport avec toute cette nature inférieure sortie du néant à l’appel divin. Tel est, tel serait du moins l’ordre naturel, ensemble harmonieux, chef-d’œuvre de bonté s’il eût existé jamais seul, mais loin encore des ineffables projets de l’Esprit d’amour.
Dans la pleine spontanéité d’une liberté qui pouvait s’abstenir et n’a d’égale que sa puissance, l’Esprit-Saint veut pour l’homme, au delà du temps, l’association à la vie même de Dieu dans la claire vision de son essence ; la vie terrestre des fils d’Adam revêtira elle-même par avance la dignité de cette vie supérieure, à tel point que celle-ci ne sera que le fruit direct, l’épanouissement régulier de la première. Aussi, pour que l’être chétif de la créature ne demeure pas au-dessous d’une telle destinée, pour que l’homme puisse suffire aux ambitions de son amour, l’Esprit fait-il que, simultanément à l’acte de création, les trois divines personnes infusent en lui leurs propres aptitudes et greffent sur ses puissances finies et bornées les puissances mêmes de la nature divine.
Cet ensemble d’une destinée supérieure à la nature et d’énergies en rapport avec cette destinée, qui se superposent aux facultés naturelles pour les transformer sans les détruire, prendra le nom d’ordre surnaturel, par comparaison avec l’ordre inférieur qui eût été celui de la nature, si les divines prévenances n’eussent ainsi dès l’abord élevé l’être humain au-dessus de lui-même. L’homme gardera de cet ordre inférieur les éléments qui constituent son humaine nature, avec l’emploi qui leur est propre ; mais tout ordre se spécifie surtout par la fin que poursuit l’ordonnateur : et la fin dernière de l’homme n’ayant jamais été autre en la pensée divine qu’une fin surnaturelle, il s’ensuivra que l’ordre naturel proprement dit n’aura jamais eu d’existence indépendante et séparée.
Vainement une orgueilleuse philosophie, s’appelant quand même « indépendante et séparée », prétendra s’en tenir aux dogmes naturels et aux vertus purement humaines : non moins que les merveilleuses ascensions des âmes fidèles, les effrayants écarts des révoltés dans les voies de l’erreur ou du crime prouveront à leur manière que la nature n’est plus, ne fut jamais pour l’homme un niveau auquel il puisse espérer se maintenir. En fût-il ainsi d’ailleurs, que l’homme ne pourrait encore légitimement se soustraire aux intentions divines. « En nous assignant une vocation surnaturelle, Dieu a fait acte d’amour ; mais il a fait acte aussi d’autorité. Son bienfait nous devient un devoir. Noblesse oblige : c’est un axiome parmi les hommes. Ainsi en est-il de la noblesse surnaturelle que Dieu a daigné conférer à la créature » [103].
Noblesse sans pareille, qui fait de l’homme non plus seulement l’image de Dieu, mais vraiment son semblable [104] ! Entre l’infini, l’éternel, et celui qui naguère n’était pas et reste à jamais créature, l’amitié, l’amour désormais sont possibles : tel est le but de la communauté d’aptitudes, de puissances, de vie, établie entre eux par l’Esprit d’amour. Ils n’étaient donc pas tout à l’heure le fruit d’un enthousiasme insensé, ces soupirs de l’homme vers son Dieu, ces tressaillements de sa chair mortelle [105] ! Elle n’était pas une vaine chimère cette soif du Dieu fort, du Dieu vivant, cette aspiration dévorante au festin de l’union divine [106] ! Rendu participant de la nature divine [107], quoi d’étonnant que l’homme en ait conscience, et se laisse entraîner par la flamme incréée vers le foyer d’où elle rayonne jusqu’à lui ? Témoin autorisé de ses propres œuvres, l’Esprit est là d’ailleurs pour confirmer le témoignage de notre conscience, et attester à notre âme que nous sommes bien les fils de Dieu [108]. C’est lui-même qui, se dérobant au plus intime de notre être où il demeure pour maintenir et conduire à bonne fin son œuvre d’amour, c’est l’Esprit qui, tantôt par de soudaines illuminations ouvrant aux yeux de notre cœur les horizons de la gloire future, inspire aux fils de Dieu les accents anticipés du triomphe [109] ; tantôt soupire en eux ces gémissements inénarrables [110], ces chants d’exil imprégnés des larmes brûlantes d’un amour pour qui l’union se fait trop attendre. Comment redire la suavité victorieuse des incomparables harmonies qui, dans le secret des âmes blessées du trait divin, montent ainsi de la terre au ciel ? Victorieux en effet seront ces soupirs ; et si l’union éternelle est trop incompatible avec les jours du pèlerinage et de l’épreuve, la vallée des larmes verra pourtant d’ineffables mystères.
Dans ce concert merveilleux de l’Esprit et de l’âme, « celui qui scrute les cœurs, nous dit l’Apôtre, connaît le désir de l’Esprit, parce qu’il prie selon Dieu pour les saints » [111]. Désir tout-puissant par suite comme Dieu lui-même ; désir, nouveau en tant que de l’homme né d’hier, mais éternel comme de l’Esprit dont l’immuable procession est avant tous les âges. En réponse au désir de l’Esprit, des insondables profondeurs de son éternité, Celui pour qui tout existe, et que nul œil mortel n’a contemplé ni ne peut voir [112], a résolu de se manifester dans le temps et de s’unir à l’homme encore voyageur, non par lui-même, mais en son Fils, la splendeur de sa gloire et l’expression très fidèle de sa substance [113]. Dieu a tant aimé le monde [114], qu’il lui adonné son Verbe, la divine Sagesse engagée à l’humanité dès le sein du Père. Figuré par le sein d’Abraham, rendez-vous mystérieux des justes sous l’ancienne alliance, lieu de repos des âmes saintes avant que ne fût ouverte au peuple élu la voie du céleste sanctuaire [115], le sein du Père est le lit nuptial chanté par David [116], d’où procède l’Époux, quittant à l’heure marquée les sommets des cieux pour chercher sa fiancée, et l’y ramenant avec lui pour l’introduire au lieu des noces éternelles. Marche triomphante de l’Époux en sa beauté [117], dont le prophète Michée a dit, parlant de son passage en Bethléhem, que le point de départ en est des jours de l’éternité [118] ! Tel est, en effet, d’après les sublimes enseignements de la théologie catholique, l’étroit rapport de la procession éternelle et de la mission dans le temps des divines personnes, qu’une même éternité les unit toutes deux en Dieu : éternellement l’auguste Trinité contemple l’ineffable naissance du Fils unique au sein du Père ; éternellement, du même regard, elle le voit procédant comme Époux du même sein paternel.
Que si maintenant nous venons à comparer entre eux les éternels décrets, il est facile de reconnaître ici le décret principal entre tous, et comme tel primant tous les autres en la pensée créatrice. Dieu le Père a tout fait pour cette union de la nature humaine avec son Fils : union si intime qu’elle devait aller, pour l’un des membres de cette humanité, jusqu’à l’identification personnelle avec le Fils très unique du Père ; union si universelle, qu’à des degrés divers, aucun des individus de la race humaine ne devait être exclu que par lui-même des noces divines avec la Sagesse éternelle ainsi manifestée dans le plus beau des enfants des hommes [119]. Ainsi « Dieu, qui d’une parole autrefois fit jaillir la lumière au sein des ténèbres, resplendit lui-même en nos cœurs, les initiant à la connaissance de la gloire divine par la face du Christ Jésus. » [120]. Ainsi le mystère des noces est-il bien le mystère du monde ; ainsi le royaume des cieux est-il semblable à un roi qui fait les noces de son fils [121].
Mais où donc se fera la rencontre ici-bas du prince et de sa fiancée ? Où doit se consommer cette union merveilleuse ? Qui nous dira la dot de l’Épouse, le gage de l’alliance ? Sait-on l’ordonnateur du banquet nuptial, et quels mets seront servis aux convives ?
A ces questions la triomphante réponse éclate aujourd’hui de toutes parts sous la voûte du ciel. A la puissance des accents sublimes que se renvoient les échos de la terre et des cieux, reconnaissons le Verbe divin. L’adorable Sagesse est sortie des temples : elle crie sur les places publiques, en tête des foules, aux portes des villes [122] ; établie sur les montagnes, occupant les points élevés des grandes routes, barrant les sentiers, elle fait entendre sa voix aux fils des hommes [123]. Et dans le même temps courent ses servantes, les grâces variées portant son message aux humbles de cœur : « Venez, mangez mon pain, buvez le vin que j’ai mélangé pour vous. » Car la Sagesse s’est bâti une demeure ici-bas ; elle a elle-même immolé ses victimes, préparé le vin et dressé sa table [124] : tout est prêt, venez au festin des noces [125] !
O Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut, atteignant d’une extrémité à l’autre et disposant toutes choses avec force et douceur [126], nous implorions au temps de l’Avent votre venue en Bethléhem, la maison du pain ; vous étiez la première aspiration de nos cœurs haletants sous l’attente des siècles. Le jour de votre glorieuse Épiphanie manifesta le mystère des noces, et révéla l’Époux ; l’Épouse fut préparée dans les eaux du Jourdain ; nous chantâmes les Mages courant avec des présents au festin figuratif, et les convives s’enivrant d’un vin miraculeux [127]. Mais l’eau changée en vin pour suppléer à l’insuffisance d’une vigne inféconde présageait de plus grandes merveilles. La vigne, la vraie vigne dont nous sommes les branches [128], a donné ses fleurs embaumées, ses fruits de grâce et d’honneur [129]. Le froment abonde dans les vallées, elles chantent un hymne de louange [130] ; car cette force du peuple couvre de ses épis jusqu’au sommet des montagnes, et sa tige nourricière domine le Liban [131].
Sagesse, noble souveraine, dont les charmes divins captivent dès l’enfance les cœurs avides de la vraie beauté [132], il est donc arrivé le jour du vrai festin des noces ! Comme une mère pleine d’honneur, comme la jeune vierge en ses attraits, vous accourez pour nous nourrir du pain de vie, nous enivrer du breuvage salutaire [133]. Meilleur est votre fruit que l’or et la pierre précieuse, meilleure votre substance que l’argent le plus pur [134]. Ceux qui vous mangent auront encore faim, ceux qui vous boivent n’éteindront pas leur soif [135]. Car votre conversation n’a point d’amertume, votre société de dégoût ; avec vous sont l’allégresse et la joie [136], les richesses, la gloire et la vertu [137].
En ces jours où siégeant dans la nuée [138], vous élevez votre trône dans l’assemblée des saints, sondant à loisir les mystères du divin banquet, nous voulons publier vos merveilles, et, de concert avec vous, chanter vos louanges en face des armées du Très-Haut [139]. Daignez ouvrir notre bouche et nous remplir de votre Esprit, divine Sagesse, afin que notre louange soit digne de son objet, et qu’elle abonde, selon votre promesse dans les saints Livres, en la bouche fidèle de vos adorateurs [140].

Les Matines.
L’Office de la nuit emprunte aujourd’hui un intérêt spécial au souvenir de cette nuit précieuse où, comme le chante l’Église, la foi nous montre le Seigneur présidant une dernière fois la Pâque figurative, et faisant suivre le banquet de l’Agneau symbolique du festin de son propre corps. Pour les raisons exposées hier, nous donnons cet Office en entier (Pour les textes de l’Office, voir ici. N.d.W.).
Afin d’exciter encore plus le zèle des fidèles pour la prière liturgique de préférence à toute autre, rappelons aussi que les Souverains Pontifes ont solennellement ouvert le trésor de l’Église en laveur de ceux qui, vraiment contrits et confessés, assisteraient à quelqu’une des Heures canoniales le jour de la Fête ou dans l’Octave. Martin V, par sa Constitution Ineffabile Sacramentum qui permet de célébrer au son des cloches et avec solennité, dans les lieux même soumis à l’interdit, la Fête et toute l’Octave du Corps du Seigneur, confirma et augmenta les indulgences accordées par Urbain IV en la Bulle Transiturus. Enfin Eugène IV, rappelant les actes des deux Pontifes [141], doubla ces indulgences, qui peuvent se résumer aujourd’hui pour les fidèles de la manière suivante. Deux cents jours sont accordés pour le jeûne de la Vigile, ou une œuvre pie remplaçant le jeûne selon l’avis du confesseur ; le jour de la Fête, quatre cents jours pour l’assistance aux premières Vêpres, et autant pour Matines, la Messe, les secondes Vêpres, deux cents jours pour la Communion indépendamment de la sainte Messe, cent soixante pour chacune des Heures de Prime, Tierce, Sexte, None et Complies, deux cents pour la Procession le jour de la Fête ou dans l’Octave ; deux cents jours également pour l’assistance aux Vêpres, Matines et Messes dans l’Octave, et quatre-vingts pour chacune des autres Heures.
L’Église débute en ses chants par la supplication matutinale accoutumée.
Vient ensuite, avec son glorieux refrain qui annonce le mystère du jour, le Cantique Invitatoire, par lequel, chaque nuit, l’Église convie ses enfants à venir adorer le Seigneur. Aujourd’hui, c’est l’Épouse qui, s’adressant à nous comme aux fidèles sujets et courtisans du Roi de gloire, excite nos hommages envers Celui dont la souveraine puissance fait ressortir d’autant plus l’ineffable bonté : « Adorons le Christ-Roi, dominateur des nations : Qui donne à ceux qui le mangent l’abondance de son esprit. » Psaume 94 (Invitatoire) .
Après l’Invitatoire, dans lequel nous avons célébré le règne social du Christ affirmé par cette fête de l’Eucharistie, l’Église entonne l’Hymne triomphante où se déroule en noble poésie le récit de la dernière Cène et l’énoncé des grands biens conférés à la terre en cette nuit précieuse.
Ces préludes étant accomplis, commence le solennel Office de la nuit, divisé, comme l’on sait, en trois Veilles ou Nocturnes.
PREMIER NOCTURNE.
Le Christ est l’homme juste par excellence ; il est l’arbre qui donne son fruit en son temps, le fruit de salut que le Seigneur nous donne à goûter au temps de sa mort. Le premier Psaume, Psaume 1 , rappelle ce beau symbolisme exalté par les Pères : « Au temps de sa mort, le Seigneur nous a donné à goûter un fruit de salut ».
Le deuxième Psaume, Psaume 4 , célèbre la paix et l’abondance de l’homme qui a mis sa confiance dans le Dieu de justice. Le froment, le vin et l’huile sont les richesses de la maison du Seigneur : c’est par ces trois éléments surtout que l’Église confère une sainteté toujours croissante aux hommes devenus ses enfants par l’eau du baptême. Mais qu’a-t-elle de meilleur, qu’a-t-elle de plus beau que le froment des élus et le vin qui fait germer les vierges [142] ? « Enrichis par l’abondance du froment et du vin, les fidèles se reposent dans la paix du Christ. »
Nous avons vu comment la très sainte Eucharistie était le lien des fidèles entre eux, le centre de la communion catholique. Ce qu’est l’immortel Sacrifice pour les chrétiens au point de vue social, les sacrifices mosaïques le furent autrefois pour les Juifs, quoique d’une façon tout extérieure et figurative. L’Antienne qui suit nous indique que l’Église a fait choix du troisième Psaume, Psaume 15 , pour rappeler sa supériorité sous ce rapport en face de la synagogue répudiée. Le Seigneur lui-même est la part glorieuse de son héritage, et le calice de sa joie. « Le Seigneur nous a rassemblés, non par le sang des veaux, mais dans la communion du calice où l’on boit Dieu lui-même. »
Les Leçons du premier Nocturne sont empruntées à saint Paul. Après avoir repris les fidèles de Corinthe des abus qui s’étaient introduits dans leurs assemblées, il raconte l’institution de la sainte Eucharistie ; il explique les dispositions avec lesquelles on doit se présenter à la table sainte, et nous montre la grandeur du crime que commet celui qui s’en approche indignement.
On remarquera l’habile contexture des Répons, composés de passages de l’Ancien et du Nouveau Testament, mis en présence pour faire ressortir l’accord de la Loi et des Prophètes avec l’Évangile au sujet de l’Eucharistie. L’Office du Saint-Sacrement se trouve ainsi enrichi des principales prophéties et figures qui l’avaient annoncé, tenant en éveil les justes de l’ancienne alliance.
DEUXIÈME NOCTURNE.
Le quatrième Psaume des Matines, Psaume 19 , célèbre l’efficacité toute-puissante du Sacrifice chrétien.
La protection du Seigneur, son secours dans les combats de la vie, la joie, la gloire et l’abondance demeurent assurés à qui sait y recourir. Car le Christ en est l’hostie, victime grasse entre toutes, holocauste dont la suave odeur monte de l’autel terrestre au sanctuaire des cieux, pour en faire descendre le salut de la droite du Très-Haut. C’est au Christ lui-même que le Psalmiste adresse ici ses vœux de victoire. « Que le Seigneur se souvienne de notre Sacrifice, et que notre holocauste lui soit agréable. »
Rien ne manque à l’âme qui suit le Seigneur. Heureuse brebis ! La houlette du Pasteur la conduit aux gras pâturages, aux eaux rafraîchissantes. Chantons avec le juste son calice enivrant, et la table préparée pour lui contre tous ceux qui le persécutent : comme un lion respirant la flamme, il sort de cette table en effet devenu terrible au démon [143]. Psaume 22 , « La table du Seigneur est dressée pour nous contre tous ceux qui nous persécutent. »
Le sixième Psaume, Psaume 41 , fut inspiré à David retenu loin du tabernacle et de l’arche sainte, lorsqu’il se dérobait à la colère de Saül dans les montagnes voisines du Jourdain. C’est ce beau cantique que nous avons cité plus haut, comme exprimant merveilleusement la soif de l’homme vers Dieu dès cette vie mortelle. La seule pensée du banquet divin le réconforte au milieu des angoisses et ranime son espoir. Laissons-nous pénétrer de cette sublime poésie : qu’elle allume ou ranime en nous la flamme de l’amour. « Que les convives du banquet divin fassent retentir un chant d’allégresse. »
Le Docteur angélique intervient lui-même directement, aux Leçons du second Nocturne, pour faire entrer notre foi dans la science du divin Sacrement, autant qu’il peut être compris par l’homme encore voyageur, et défini par l’intelligence humaine. « Ce sont les paroles mêmes du Seigneur approuvant la doctrine de Thomas sur le Sacrement de son Corps. » Trois villes successivement, Paris, Naples et Orvieto, eurent l’honneur de servir de théâtre à ces manifestations si glorieuses du Christ à son Docteur. On vénère encore à Orvieto, dans l’Église de Saint-Dominique, le Crucifix qui prit ainsi la parole pour donner l’approbation divine à l’Office même qui est sous nos yeux. Écoutons donc avec un pieux respect, et ne nous laissons pas effrayer par une terminologie scolastique qui n’est pas la science, mais le vêtement de combat dont il parut bon de la munir pour les champs clos de la dialectique.
TROISIÈME NOCTURNE.
Le septième Psaume, Psaume 42 , fait suite au précédent dans l’ordre du Psautier. Une même situation les inspire, une même pensée domine leur composition, s’exprimant aussi dans les mêmes termes : le cri de l’âme harcelée par l’ennemi, soupirant vers son Dieu, le désir et la confiance de revoir enfin la montagne sainte et cet autel où Dieu se donne en la personne du Verbe incarné, le Christ, qui vient renouveler la jeunesse de ses heureux adorateurs et convives. « Je m’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu : je recevrai le Christ qui renouvelle ma jeunesse. »
Le huitième Psaume, Psaume 80 , célèbre avec enthousiasme la souveraine bonté du Dieu de Jacob. Par mille prodiges il a délivré son peuple ; il lui a dit : « Ouvre ta bouche, et je la remplirai » ; et malgré les trop nombreuses indocilités de ses fils ingrats, il tient aujourd’hui sa promesse. Il les nourrit de la graisse du froment, il les rassasie du miel de la pierre, qui sont les ineffables douceurs du Christ froment des élus et pierre du désert [144]. « Le Seigneur nous a nourris de la graisse du froment ; il nous a rassasies du miel de la pierre. »
Le Christ est le Dieu vivant en qui tressaillent notre cœur et notre chair. Chantons, avec le neuvième Psaume, Psaume 83 , les autels du Dieu des armées, notre Roi et notre Dieu ; ils sont le refuge du passereau, le nid de la tourterelle. Heureux qui habite ces fortunes tabernacles ! « A votre autel, Seigneur, nous recevons le Christ, en qui tressaillent notre cœur et notre chair. »
On lit le commencement de l’Évangile de la Messe, et l’interprétation nous en est donnée par saint Augustin. Il insiste sur l’unité que le Seigneur a en vue d’établir chez les siens par l’auguste Sacrement ; il montre la nécessité des dispositions intérieures requises pour y participer avec fruit, et en relève l’effet qui est de faire vivre l’homme pour le Christ, comme lui-même vit pour son Père.
Les trois Veilles de la nuit sont épuisées. L’Église a veillé dans l’attente de l’Époux, chantant ses louanges pour tromper les ennuis de ces heures trop lentes, et hâtant de ses aspirations enflammées l’arrivée du Bien-Aimé. Heureuse est-elle ! car heureux les hommes que le Seigneur, au jour des noces, trouve veillants de la sorte à son arrivée, pour lui ouvrir dès qu’il aura frappé : « En vérité, je vous le dis, s’écrie le Sauveur dans l’Évangile, il se ceindra lui-même, les fera prendre place à table, et allant et venant les servira de ses mains ; et s’il vient à la seconde veille, et s’il vient à la troisième veille, et qu’il les trouve ainsi, bienheureux sont-ils [145] ! » Les pieux interprètes de la sainte Liturgie ont vu dans ces longues divisions de l’Office appelées Nocturnes, qui se déroulent en dehors des sept Heures canoniques du jour, l’image des longs siècles où le genre humain, plongé dans l’ombre et sous le coup des divines inimitiés, implorait la venue du Médiateur qui devait le justifier dans son sang [146], et ramener la lumière en rétablissant avec le ciel l’harmonie rompue par le péché d’origine. Non moins que les prières des Patriarches et les aspirations des Prophètes, par avance aussi les soupirs de l’Église et de tous les justes abrégèrent alors les temps du Messie, et rapprochèrent du point de départ l’heure du grand Sacrifice qui est venu donner fin au péché, manifester au monde la justice éternelle, et confirmer l’alliance avec un grand nombre [147].
Mais chaque jour encore l’Église attend l’Époux : s’il n’est venu qu’une fois pour mourir, chaque jour il descend des cieux pour féconder son Épouse dans l’acte du Sacrifice quotidien, où se fait l’incessante application des mérites de celui de la Croix offert une seule fois pour la durée des siècles. Cette venue quotidienne du Seigneur est le point culminant de la journée de l’Église, partageant sa vie terrestre entre le désir et l’action de grâces. Sept fois le jour, elle laisse éclater au dehors les sentiments qui débordent en elle, et convie ses fils au sacrifice de louange, épanouissement radieux du Sacrifice eucharistique. Ainsi faisait le royal prophète [148]. Comme lui, elle établit les chantres en face de l’autel, et met en leurs bouches de douces mélodies [149].
Lorsqu’en effet David eut transporté dans Jérusalem l’arche sainte avec cette pompe qui est racontée dans les saints Livres, après que tous les sacrifices furent accomplis [150], il laissa devant l’arche un chœur de lévites choisis, pour célébrer les merveilles du Seigneur et louer au nom de tous le Dieu d’Israël [151]. Plus tard, lorsque, plein de jours, il couronna roi en Sion ce fils qui, plus heureux que lui, devait bâtir le temple de Jéhovah [152], David remit à Salomon les plans de l’édifice sacré qui allait remplacer dans sa stabilité la tente du désert, et il voulut aussi fixer lui-même l’organisation définitive du culte divin réclamée par le nouvel ordre de choses [153]. Aux vingt-quatre familles sacerdotales désignées pour se relever hebdomadairement dans l’oblation des sacrifices, étaient adjoints comme naturel complément quatre mille chantres ou psalmistes [154], répartis eux-mêmes en vingt-quatre séries pour perpétuer le ministère de la prophétie ou louange, sous la conduite d’Asaph, Héman et Idithun, et recevant les leçons de deux cent quatre-vingt-huit de leurs frères, tous savants dans la science du chant sacré et prophétisant sur la cithare, les cymbales et le psaltérion [155]. La louange alors était prophétie, comme chez nous elle est confession : ils chantaient dans l’espérance, comme nous chantons dans la foi ; mais l’objet de nos chants est le même, à savoir le Christ Sauveur, et c’est ainsi que le recueil des formules sacrées d’Israël a passé tout entier dans l’Église.
Type parfait du Messie, non content de fournir au peuple ancien dans des psaumes inspirés le thème de ses chants, David apparaît mêlé aux lévites, vêtu comme eux de la tunique de lin et présidant leurs concerts, au jour solennel de la translation de l’arche en la ville sainte [156]. « Chantre illustre, s’écrie le pieux et profond Abbé Rupert, il conduit les chœurs sacrés, et danse devant l’arche de l’alliance du Seigneur. O roi, ô prince des sacrés rites ! Où tend donc l’enthousiaste transport d’une si noble tête ? Voilà que celui qui n’est point de la race sacerdotale commande aux prêtres, classe les lévites, organise les chœurs, choisit les chantres pour l’arcane, pour l’octave, pour l’hymne de la victoire, et détermine qui sonnera des trompettes, qui frappera les cymbales, qui touchera la lyre, la guitare ou la harpe sacrée. En toutes ces démarches il voit son fils, il ose remplir un rôle qu’il savait devoir convenir à ce fils son Seigneur. Car l’arche sainte désigne l’humanité du Christ Sauveur, contenant la manne du Verbe, les tables du Testament, et la verge de la puissance royale et sacerdotale. C’est pourquoi notre David, ayant renversé l’empire de la mort, comme le premier celui de Saül, conduit en Jérusalem l’arche de l’alliance et la place dans le tabernacle dressé par lui-même. Ce que voyant l’Église, à l’exemple de l’ancien peuple, elle s’excite à chanter avec le vrai David. Toute la multitude des fils de Jacob chante donc harmonieusement, et David lui-même avec eux touche la cithare en la maison du Seigneur. Car tout ce que chante Israël, il l’apprend du maître, il l’exécute sous la conduite et la mesure de ce chef du chant sacré, de ce præcentor frappant du doigt de Dieu les harpes des cœurs. Excitée par lui, l’allégresse des âmes éclate en sons corporels, en mélodieux concert, tantôt grave, tantôt perçant t ou grandiose ; et sous le souffle d’une même foi, résonnant partout aux mêmes heures, ce chant un et multiple de l’immense corps de l’Église répandue dans toutes les nations, apporte de toutes parts au Christ son centre une suave harmonie » [157]
Mais déjà l’aurore s’annonce au ciel. Penchée vers l’Orient, l’Église a vu dans ces lueurs l’indice de l’arrivée prochaine de l’Époux. Elle tressaille au moment où va paraître enfin l’astre du jour ; et le solennel Office des Laudes, tout d’allégresse et de louange, comme son nom même, invite la terre, la mer et les cieux à célébrer dignement le lever du Christ, soleil véritable, qui s’élance de l’horizon comme un géant vers la montagne du Sacrifice.

Les Laudes.
(Pour les textes de l’Office, voir ici. N.d.W.)
Le premier Psaume des Laudes, Psaume 92 , nous montre dans sa force et son infinie grandeur le Seigneur roi des nations caché dans l’Hostie. Par l’immortel Sacrifice il raffermit la terre ébranlée. La voix des grandes eaux est imposante ; mais plus puissante encore est sur le ciel la voix de l’auguste Victime. La divine Sagesse en rend aujourd’hui témoignage : c’est elle qui a bâti la maison et dressé la table du Sacrifice. Marchons en sa présence dans une sainteté digne de cette maison, dont elle manifeste aujourd’hui au monde l’incomparable trésor. « La Sagesse s’est bâti une maison, elle a mélangé son vin et dressé sa table. Alléluia. »
Le Psaume suivant, Psaume 99 , convoque tous les habitants de la terre à entrer dans la maison de la divine Sagesse, pour y célébrer comme il convient la douce présence de celle dont les délices sont d’habiter ainsi parmi les enfants des hommes. Et pourtant, elle est le Seigneur de gloire, le Dieu qui nous a créés. Nous sommes son peuple et les brebis de son heureux pâturage : chantons son amour dans l’allégresse et la reconnaissance. « Vous avez nourri votre peuple de l’aliment des Anges, vous lui avez donné le pain du ciel. Alléluia. »
Les deux Psaumes suivants que l’Église réunit en un seul, Psaume 62 et Psaume 66 [158], sont le cri de l’âme fidèle au moment où l’aurore paraît enfin. Elle a été réveillée par la soif de son Dieu ; elle se consume dans l’attente du pain de vie qui doit l’engraisser de la substance du Christ et la remplir de royales délices. Aujourd’hui, elle tressaille à la pensée du solennel triomphe qui va produire à la face du monde l’objet de son amour, et faire pour quelques heures un temple auguste de cette terre déserte, aride et sans eau. Partout les peuples vont s’unir dans un sentiment commun d’adoration, d’allégresse et de louange ; les nations reconnaissantes exalteront en ce jour le fruit divin que la terre a produit. « Le pain du Christ engraisse l’âme, et il fera les délices des rois. Alléluia. »
Le Cantique dans lequel les trois enfants de la fournaise de Babylone appelaient toutes les créatures de Dieu à bénir son Nom, vient aujourd’hui encore prêter une voix à toute la nature, et convier l’œuvre de Dieu tout entière à louer son auteur. Il est bien juste que les cieux et la terre s’unissent pour rendre hommage à Celui qui, dans le grand Sacrifice renouvelé chaque jour par la main du prêtre, a réuni toutes choses au ciel et sur la terre [159]. Cantique des trois Enfants , « Les prêtres seront saints pour offrir à Dieu l’encens et le pain du Sacrifice. Alléluia. »
Ces trois derniers Psaumes que l’Église réunit en un seul sont aussi les derniers du Psautier [160]. Ils renferment la louange du Seigneur, et convoquent toutes les créatures à le célébrer. Le premier, Psaume 148 , offre un grand rapport avec le Cantique des trois enfants ; le deuxième, Psaume 149, convie les Saints à chanter le Seigneur qui les a glorifiés et associés par l’Hostie sainte à ses félicités comme à sa puissance ; le troisième, Psaume 150, invite tout ce qui respire à former, en l’honneur du Dieu toujours présent avec nous, le plus brillant et le plus harmonieux concert.
Le Capitule qui vient ensuite est tiré de la première Épître de saint Paul aux Corinthiens. Nous avons déjà vu ce passage, accompagné de ce qui le précède et le suit, dans les Leçons du premier Nocturne.
L’Hymne des Laudes est célèbre par l’admirable strophe, la quatrième, qui résume si complètement dans sa brièveté gracieuse le mystère du Christ Jésus, compagnon, nourriture, rançon et récompense de l’homme. Chantons-la dans la reconnaissance, la confiance et l’amour.
On entonne ensuite le Cantique de Zacharie, Benedictus ,par lequel l’Église salue, chaque matin, le lever du soleil. Il célèbre la visite du Seigneur, l’accomplissement des promesses de Dieu, l’apparition du divin Orient au milieu de nos ténèbres.
Le soleil s’est levé dans sa splendeur, au milieu des harmonies montant du sanctuaire à la rencontre du divin Orient. Pendant que les interprètes de la psalmodie sacrée achèvent d’offrir pour le monde au Dieu Créateur et Sauveur le solennel tribut des Laudes matutinales, les premiers rayons de l’astre du jour éclairent partout, en dehors du temple, le spectacle d’une activité universelle où n’ont de part ni le désir du gain, ni la soif des plaisirs. Une nouvelle de salut s’est fait entendre ; un cri d’allégresse a retenti dans la maison des justes [161] : « Dieu s’apprête à visiter son peuple. L’Emmanuel présent dans l’Hostie va quitter son temple. Il doit descendre en vos cités, en vos fertiles campagnes, tenir sa cour aux champs de la forêt [162]. Sous le feuillage, dressez son trône ; sur son parcours, semez les fleurs et la verdure jusqu’à la corne de l’autel » [163].
A cette annonce, un saint enthousiasme s’est ému dans les âmes. Dès les jours précédents, en plus d’un cœur fidèle s’est renouvelé le vœu de David au Dieu de Jacob : « Non, je ne veux point remonter sur ma couche, je n’accorderai point de sommeil à mes yeux, jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu convenable pour le Seigneur, dressé une tente au Dieu de Jacob [164] ! »
Reposoirs sacrés où s’arrêteront les pieds du Roi pacifique [165], délicieuses conceptions, chefs-d’œuvre d’un jour, qui, chaque année, mettez en lumière l’exquise poésie que nourrit l’amour dans le peuple fidèle, vous réunissez à cette heure, dans une même pensée de rivalité sainte, les plus humbles villages et les divers quartiers des cités populeuses. Sur tous les cœurs chrétiens, dans ceux-là même chez qui la grâce depuis longtemps bannie semblait avoir perdu tout empire, le Mystère de la foi fait sentir sa puissance ; et la femme chrétienne, la fille, la sœur, dont chaque fête du Cycle augmentait l’angoisse sur l’aveuglement obstiné d’êtres chéris, tressaillent en les voyant s’empresser eux-mêmes aux apprêts du prochain triomphe de l’Emmanuel, et se dépenser pour le Dieu de l’Hostie. C’est le réveil de la foi dans les baptisés ; c’est la grâce du Sacrement d’amour opérant à distance, grâce de ressouvenir et de conversion pour les âmes assoupies ou endurcies, jusqu’aux confins de la terre et dans toutes les familles des nations [166]. Les cieux se réjouissent ; la terre triomphe ; la mer est émue sur tous ses rivages. Les campagnes tressaillent sous l’éclat de leur fraîche parure de printemps ; noyées dans les flots d’une lumière embaumée, elles députent en allégresse fleurs et parfums au Roi des cieux traversant leurs sentiers. A la grande nouvelle ont tressailli tous les bois des forêts à leur tour [167] : de chaque colline descendent et montent à la cité leurs verts branchages, sur toutes les routes se hâtent leurs forêts ambulantes ; ils arrivent, refoulant devant eux le bruit des chars et le mouvement des affaires ; ils se rangent, se pressent en allées ombreuses, enlacent leurs rameaux et forment ces berceaux de verdure que daignera visiter bientôt leur Seigneur et le nôtre.
Tenons à honneur d’avoir une part en cet immense concours ; sentons le frémissement de la nature entière à l’approche de son Dieu, partageons ses transports ; et durant les heures qui doivent s’écouler encore d’ici l’oblation du grand Sacrifice, gardons-nous de rester indifférents aux préparatifs des solennelles manifestations où l’amour du Christ-Roi vient réclamer les hommages qui lui sont dus.
A Tierce.
Les heures ont fui rapides dans la sainte hâte des derniers préparatifs. Tout est prêt maintenant pour le triomphe de l’Emmanuel ; et les joyeuses volées des cloches du beffroi, convoquant les fidèles au grand Sacrifice, annoncent la fin des pieux travaux. Nous offrirons, en manière de repos, à nos lecteurs, cette page tracée comme essai sur la fête par une main chère à leurs âmes, et que nous avons retrouvée, trop seule, hélas ! Dans les manuscrits de l’auteur de l’Année liturgique. Le respect ému qui s’impose à nous, en présence de ces dernières lignes de notre vénéré Père et Maître, nous fait un devoir de ne modifier que le moins possible le style même de ces notes disputées aux dernières fatigues de sa vie si remplie.
« La grande solennité a lui enfin, et tout l’annonce comme le triomphe de la foi et de l’amour. Nous le disions naguère, aux jours de l’Ascension, interprétant la parole du Christ : « Il vous est expédient que je me retire » [168]. La soustraction de la présence visible de l’Homme-Dieu aux regards des mortels devait amener en eux, par l’énergique opération de l’Esprit-Saint, une plénitude de lumière et une ferveur d’amour dont le Sauveur n’avait pas été l’objet dans le cours de sa vie mortelle. Marie seule, illuminée du feu divin, avait pu accomplir envers lui, durant cette période, les devoirs que la sainte Église lui rend aujourd’hui.
Saint Thomas, dans son hymne céleste, chante ainsi : « Sur la croix, la divinité seule se dérobait aux regards ; ici, c’est l’humanité elle-même qui s’est cachée » [169]. Et néanmoins, en aucun jour de l’année la sainte Église n’est plus triomphante, ni plus démonstrative. Le ciel est radieux ; la terre a revêtu sa parure brillante, pour en faire hommage à celui qui dit : « Je suis la fleur des champs » et le lis des vallons » [170]. La sainte Église, non contente d’avoir préparé un trône sur lequel la mystérieuse Hostie recevra, durant toute une Octave, les hommages d’une cour empressée, a jugé que la pompe d’un triomphe doit précéder ces solennelles et miséricordieuses assises. Aujourd’hui, elle ne se contentera plus d’élever le Pain sacré, après la prononciation des paroles divines ; elle lui fera franchir le seuil du temple, au milieu des flots de l’encens, à travers les fleurs et la feuillée, et le peuple catholique, fléchissant les genoux, adorera de toutes parts sous la voûte du ciel son Roi et son Dieu.
Elles ne sont donc pas épuisées ces joies que chaque solennité de l’Année liturgique était venue successivement nous apporter. Elles revivent toutes dans celle d’aujourd’hui. Le roi-prophète l’avait prédit : « Le Seigneur a créé un mémorial de toutes ses merveilles : c’est l’aliment qu’il a préparé à ceux qui l’honorent » [171]. La sainte Église tressaille d’enthousiasme, tenant entre ses mains l’Époux divin qui a dit : « Voici que je demeure avec vous jusqu’à la consommation du monde » [172]. La promesse était formelle, et elle s’est accomplie. Nous le vîmes s’élever, il est vrai, de la cime du mont des Oliviers et aller s’asseoir à la droite du Père. Mais depuis le jour sacré de la Pentecôte où l’Esprit divin a pris possession de la sainte Église, le mystère auguste de la Cène sacrée s’est accompli, en vertu des paroles souveraines : « Faites ceci en mémoire de moi » ; et dès lors la race humaine n’a plus été veuve de son Chef et de son Sauveur.
Quoi d’étonnant alors que l’Église, en possession du Verbe de Dieu devenu ainsi sa chose, ait avancé tout à coup dans l’intelligence ? Les espèces sacramentelles qui protègent le mystère sont là, mais elles ne restent que pour introduire dans l’invisible… »
Telles sont les dernières paroles du Maître. Arrêtées par la mort au moment où devait s’épanouir sous sa plume, en de sublimes clartés, l’ineffable mystère des noces divines au banquet sacré, elles sont suivies de l’indication de plusieurs passages de saint Augustin ayant trait à l’union du Verbe et de l’homme, de la divine Sagesse et de l’humanité dans les Mystères. Léguée silencieusement des rives de l’éternité aux continuateurs de son œuvre, cette indication suprême a été notre point de départ et notre loi souveraine en cette Octave. Qu’on pardonne aux fils de n’avoir point hésité pour aller recueillir jusque sur de tels sommets l’héritage de leur Père : ils l’ont fait dans la confiance que la forte éducation reçue de lui jusqu’ici par l’âme chrétienne, la mettrait à même de moins sentir leur propre faiblesse. Cette formation progressive, qui a conduit le chrétien des clartés tempérées de l’Avent aux radieuses splendeurs de la Pentecôte, doit l’avoir préparé à goûter plus directement désormais la sublimité des Écritures et des Pères, nos guides fidèles et constants dans ces hauteurs qu’il nous faut maintenant aborder. Tels étaient bien au reste la pensée et l’espoir de l’auteur même de cet ouvrage, quand il écrivait au temps de Noël :
« Dans le mystère de Noël et des quarante jours de la Naissance, la lumière est encore proportionnée à notre faiblesse. C’est le Verbe divin, sans doute, la Sagesse du Père, qui nous est proposé à connaître et à imiter ; mais ce Verbe, cette Sagesse, apparaissent sous les traits de l’enfance... Or, toute âme introduite dans Bethléhem, c’est-à-dire dans la Maison du Pain, unie à Celui qui est la Lumière du monde [173], cette âme ne marche plus dans les ténèbres... Sa lumière ne s’éteint plus. Elle doit même croître à mesure que le Cycle liturgique va se développer. Puissions-nous réfléchir assez fidèlement dans nos âmes le progrès de cette lumière, et parvenir par son aide au bien de l’union divine qui couronne à la fois le Cycle et l’âme sanctifiée par le Cycle [174] ! »
Après cette digression, qui nous a semblé utile, nous reprenons l’explication des textes liturgiques propres à la fête.
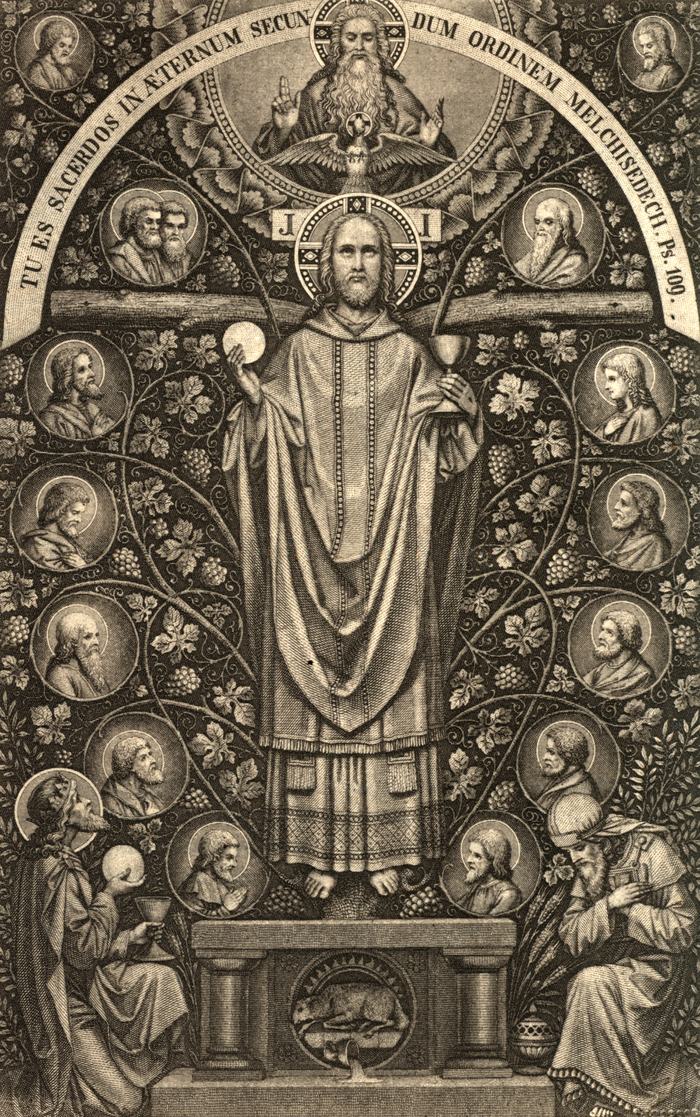
A la Messe.
La Procession, qui suit immédiatement l’Office de Tierce dans les autres fêtes de l’année [175], n’aura lieu aujourd’hui qu’après l’oblation du Sacrifice. Le Christ lui-même y doit présider en personne : il faut donc attendre que l’Action sacrée ait abaissé jusqu’à nous la hauteur des cieux où il réside [176]. Bientôt il sera sous la nuée mystérieuse. Il vient nourrir ses élus delà graisse du froment tombé en terre [177], et multiplié par l’immolation mystique sur tous les autels ; il vient en ce jour triompher parmi les siens, entendre nos cris d’allégresse au Dieu de Jacob. Telles sont les pensées qu’interprète le solennel Introït par lequel l’Église ouvre ses chants. Il est formé de passages du beau Psaume LXXX, que nous avons vu plus haut tout entier dans l’Office des Matines.
Dans la Collecte, l’Église rappelle l’intention du Seigneur instituant le Sacrement d’amour à la veille de sa mort, comme mémorial de la Passion qu’il devait bientôt subir. Elle demande que, pénétrés ainsi de sa vraie pensée dans les honneurs rendus par nous au Corps et au Sang divins, nous obtenions l’effet de son Sacrifice.
ÉPÎTRE.
La très sainte Eucharistie, comme Sacrifice et comme Sacrement, est le centre même de la religion chrétienne ; aussi le Seigneur a-t-il voulu que le fait de son institution reposât, dans les écrits inspirés, sur un quadruple témoignage. Saint Paul, que nous venons d’entendre, unit sa voix à celles de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc. Il appuie son récit, conforme en tout à celui des Évangélistes, sur la propre parole du Sauveur lui-même, qui daigna lui apparaître et l’instruire en personne après sa conversion.
L’Apôtre insiste sur le pouvoir que le Sauveur donna à ses disciples de renouveler l’action qu’il venait de faire, et il nous enseigne en particulier que chaque fois que le Prêtre consacre le corps et le sang de Jésus-Christ, il annonce la mort du Seigneur, exprimant par ces paroles l’unité du Sacrifice sur la croix et sur l’autel. C’est aussi par l’immolation du Rédempteur sur la croix que la chair de cet Agneau de Dieu est devenue « véritablement une nourriture », et son sang « véritablement un breuvage », comme nous le dira bientôt l’Évangile du jour. Que le chrétien donc ne l’oublie pas, même en ce jour de triomphe. Nous le voyons tout à l’heure : l’Église dans la Collecte, cette formule principale, expression de ses vœux et de ses pensées qu’elle répétera sans cesse en cette Octave, n’avait pas d’autre but que d’inculquer profondément dans l’âme de ses fils la dernière et si touchante recommandation du Seigneur : « Toutes les fois que vous boirez à ce calice de la nouvelle alliance, faites-le en mémoire de moi. » Le choix qu’elle fait pour Épître de ce passage du grand Apôtre doit donner toujours plus à comprendre au chrétien que la chair divine qui nourrit son âme a été préparée sur le Calvaire, et que, si l’Agneau est aujourd’hui vivant et immortel, c’est par une mort douloureuse qu’il est devenu notre aliment. Le pécheur réconcilié recevra avec componction ce corps sacré, dont il se reproche amèrement d’avoir épuisé tout le sang par ses péchés multipliés ; le juste y participera avec humilité, se souvenant que lui aussi a eu sa part trop grande aux douleurs de l’Agneau innocent, et que si, aujourd’hui, il sent en lui la vie de la grâce, il ne le doit qu’au sang de la Victime dont la chair va lui être donnée en nourriture.
Mais redoutons sur toutes choses la sacrilège audace flétrie par l’Apôtre, et qui ne craindrait pas d’infliger, par un monstrueux renversement, une nouvelle mort à l’Auteur de la vie, dans le banquet même dont son sang fut le prix ! « Que l’homme donc s’éprouve lui-même, dit saint Paul, et qu’alors seulement il mange de ce pain et boive de ce calice. » Cette épreuve, c’est la confession sacramentelle pour tout homme avant conscience d’un péché grave non encore accusé : quelque repentir qu’il puisse en avoir, et fût-il déjà réconcilié avec Dieu par un acte de contrition parfaite, le précepte de l’Apôtre, interprété par la coutume de l’Église et ses définitions conciliaires [178], lui interdit l’accès de la table sainte, tant qu’il n’a pas soumis sa faute au pouvoir des Clefs.
Le Graduel et le Verset alléluiatique présentent un nouvel exemple de ce parallélisme entre les deux Testaments, que nous avons remarqué dans la contexture des Répons de l’Office Nocturne. Le Psalmiste [179] y exalte la bonté infinie du Seigneur, dont tout être vivant attend sa nourriture ; et le Sauveur s’y présente lui-même à nous, dans saint Jean [180], comme l’aliment véritable.
Vient ensuite la Séquence, œuvre célèbre et toute singulière du Docteur angélique, où l’Église, la vraie Sion, manifeste son enthousiasme, épanche son amour pour le Pain vivant et vivifiant, en des termes d’une précision scolastique qui semblerait devoir défier toute poésie dans la forme. Le mystère eucharistique s’y développe avec la plénitude concise et la majesté simple et grandiose dont l’Ange de l’École eut le secret merveilleux. Cette exposition substantielle de l’objet de la fête, soutenue par un chant en harmonie avec la pensée, justifie pleinement l’enthousiasme excite dans l’âme par la succession de ces strophes magistrales.
ÉVANGILE.
Le disciple bien-aimé ne pouvait rester silencieux sur le Mystère d’amour. Cependant, quand il écrivit son Évangile, l’institution du Sacrement divin était déjà suffisamment racontée par les trois Évangélistes qui l’avaient précédé et par l’Apôtre des Gentils. Sans donc revenir sur cette divine histoire, il compléta leur récit par celui de la solennelle promesse qu’avait faite le Seigneur, un an avant la Cène, au bord du lac de Tibériade.
Aux foules nombreuses qu’attire après lui le récent miracle de la multiplication des pains et des poissons, Jésus se présente comme le vrai pain de vie venu du ciel, et préservant de la mort, à la différence de la manne donnée par Moïse à leurs pères. La vie est le premier des biens, comme la mort le dernier des maux. La vie réside en Dieu comme en sa source [181] ; lui seul peut la communiquer à qui il veut, la rendre à qui l’a perdue. Créé dans la vie par sa grâce, l’homme, par le péché, encourut la mort. Mais Dieu aime le monde de telle sorte qu’au monde perdu il envoie son Fils [182], avec la mission de vivifier l’homme à nouveau dans tout son être. Vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, le Fils unique est aussi vraie vie de vraie vie par nature ; et comme le Père illumine ceux qui sont dans les ténèbres par ce Fils sa lumière, ainsi donne-t-il la vie aux morts dans ce même Fils sa vivante image [183].
Le Verbe de Dieu est donc venu parmi les hommes, pour qu’ils eussent la vie et qu’ils l’eussent abondamment [184]. Et comme c’est le propre de la nourriture d’augmenter, d’entretenir la vie, il s’est fait nourriture, nourriture vivante et vivifiante descendue des cieux. Participant elle-même de la vie éternelle qu’il puise directement au sein du Père, la chair du Verbe communique cette vie à qui la mange. Ce qui est corruptible de sa nature, dit saint Cyrille d’Alexandrie, ne peut être autrement vivifie que par l’union corporelle au corps de celui qui est vie par nature ; or, de même que deux morceaux de cire fondus ensemble par le feu n’en sont plus qu’un seul, ainsi fait de nous et du Christ la participation de son corps et de son sang précieux.
Cette vie donc qui réside en la chair du Verbe, devenue nôtre en nous-mêmes, ne sera pas plus qu’en lui vaincue par la mort ; elle secouera au jour marqué les liens de l’antique ennemie, et triomphera de la corruption dans nos corps immortels [185]. Aussi l’Église, dans son sens exquis d’Épouse et sa délicatesse maternelle, emprunte à ce même passage de saint Jean l’Évangile de la Messe quotidienne des défunts, recueillant les pleurs des vivants sur ceux qui ne sont plus au pied de l’Hostie sainte, à la source même de la vraie vie, centre assuré de leurs communes espérances.
Ainsi fallait-il que non seulement l’âme fût renouvelée par le contact du Verbe, mais que lui-même, ce corps terrestre et grossier participât dans sa mesure à la vertu vivifiante de l’Esprit, selon l’expression du Seigneur [186]. « Ceux qui ont absorbe du poison par l’artifice de leurs ennemis, dit admirablement saint Grégoire de Nysse, éteignent le virus en eux par un remède opposé ; mais de même qu’il est arrivé du breuvage mortel, il faut que la potion salutaire soit introduite jusque dans leurs entrailles, afin que de là se répande en tout l’organisme la vertu curative. Nous donc qui avons goûté le fruit délétère, nous avons besoin d’un remède de salut qui, de nouveau, rassemble et harmonise en nous les éléments désagrégés et confondus de notre nature, et qui, pénétrant l’intime de notre substance, neutralise et repousse le poison par une force contraire. Quel sera-t-il ? Nul autre que ce corps qui s’est montré plus puissant que la mort, et a posé pour nous le principe de la vie. Comme un peu de levain, dit l’Apôtre, s’assimile toute la pâte [187], ainsi ce corps, entrant dans le nôtre, le transforme en soi tout entier. Mais rien ne peut pénétrer ainsi notre substance corporelle que par le manger et le boire ; et c’est là le mode, conforme à sa nature, par lequel arrive jusqu’à notre corps la vertu vivifiante » [188].
L’Offertoire est formé d’un passage du Lévitique [189] où le Seigneur recommande la sainteté aux prêtres de l’ancienne alliance, en raison de l’offrande qu’ils faisaient à Jéhovah de l’encens symbolique et des pains de proposition. Autant le sacerdoce du Testament nouveau l’emporte sur le ministère de la loi des figures, autant doivent l’emporter en sainteté sur les mains d’Aaron celles qui présentent à Dieu le Père le vrai Pain des cieux, comme un encens de parfaite odeur
Le Prêtre demande pour l’Église, dans la Secrète, l’unité et la paix qui sont la grâce spéciale du divin Sacrement, comme l’enseignent les Pères d’après la composition même des dons sacrés formés des grains nombreux du froment ou de la vigne réunis sous la meule ou le pressoir.
Vient ensuite la Préface, qui est aujourd’hui et durant l’Octave celle de la Nativité du Sauveur, pour nous rappeler l’intime connexion des deux mystères de Noël et du divin Sacrement. C’est en Bethléhem, la Maison du Pain, que Jésus, vrai Pain de vie, est descendu des cieux par le sein de la Vierge-mère.
Fidèle au précepte du Christ intimé de nouveau par l’Apôtre en l’Épître de la fête, l’Église rappelle à ses fils dans l’Antienne de la Communion que, recevant le Corps du Seigneur, ils annoncent sa mort, et doivent se garder dans une sainte frayeur d’approcher indignement des Mystères du salut.
L’Église conclut les Mystères en demandant pour l’éternité l’union sans voiles au Verbe divin, cette union parfaite dont la participation transitoire et voilée à la réelle substance du Corps et du Sang précieux est ici-bas le gage et la figure.
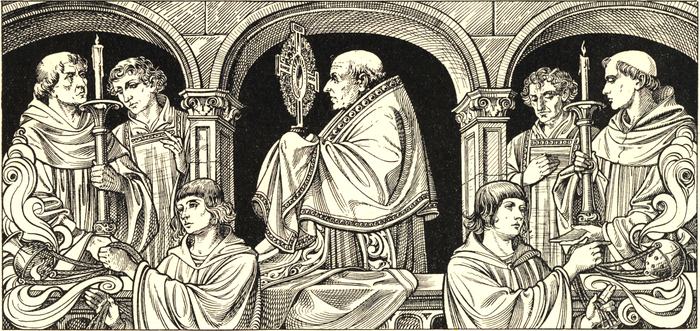
La Procession.
Quelle est celle-ci qui s’avance embaumant le désert du monde d’un nuage d’encens, de myrrhe et de toutes sortes de parfums ? D’elle-même aujourd’hui l’Épouse s’est réveillée. Pleine de désirs et d’attraits, l’Église entoure la litière d’or où parait l’Époux dans sa gloire. Près de lui sont rangés les forts d’Israël, prêtres et lévites du Seigneur puissants contre Dieu. Filles de Sion, sortez à la rencontre ; contemplez le vrai Salomon sous l’éclat du diadème dont l’a couronné sa mère au jour de ses noces et de la joie de son cœur [190]. Ce diadème, c’est la chair reçue par le Verbe divin de la Vierge très pure, quand il prit l’humanité pour épouse [191]. Par ce corps très parfait, par cette chair sacrée se poursuit tous les jours, au saint banquet, l’ineffable mystère des noces de l’homme et de la Sagesse éternelle. Pour le vrai Salomon chaque jour donc est encore celui de l’allégresse du cœur et des joies nuptiales. Quoi de plus juste qu’une fois l’année, la sainte Église donne carrière à ses transports envers l’Époux divin caché sous les voiles du Sacrement d’amour ? C’est pour cela qu’aujourd’hui le Prêtre a consacré deux Hosties, et qu’après avoir consommé l’une d’elles, il a placé l’autre dans le radieux ostensoir qui, soutenu par ses mains tremblantes, va traverser maintenant sous le dais, au chant des hymnes triomphales, les rangs émus de la foule prosternée.
Cette solennelle démonstration envers l’Hostie sainte, nous l’avons déjà dit, est d’origine plus récente que la fête elle-même du Corps du Seigneur. Urbain IV n’en parle pas dans sa Bulle d’institution, en 1264. Par contre, Martin V et Eugène IV, en leurs Constitutions citées plus haut (26 mai 1429, 26 mai 1433), fournissent la preuve qu’elle était en usage de leur temps, puisqu’ils accordent des indulgences à ceux qui la suivent. Le Milanais Donat Bossius rapporte, en sa Chronique, que « le jeudi 29 mai 1404, on porta pour la première fois solennellement le Corps du Christ dans les rues de Pavie, comme il est passé depuis en usage. » Quelques auteurs en ont conclu que la Procession de la Fête-Dieu ne remontait pas au delà de cette date, et devait sa première origine à l’Église de Pavie. Mais cette conclusion dépasse le texte sur lequel elle s’appuie, et qui peut fort bien n’exprimer qu’un fait de chronique locale. Nous trouvons en effet la Procession mentionnée sur un titre manuscrit de l’Église de Chartres en 1330, dans un acte du Chapitre de Tournai en 1325, au concile de Paris en 1323, et, en 1320, dans celui de Sens. Des indulgences sont accordées par ces deux conciles à l’abstinence et au jeûne de la Vigile du Corps du Seigneur, et ils ajoutent : « Quant à la Procession solennelle qui se fait le jeudi de la fête en portant le divin Sacrement, comme il semble que ce soit par une sorte d’inspiration divine qu’elle s’est introduite en nos jours, nous ne statuons rien pour le présent, laissant toutes choses à la dévotion du clergé et du peuple » [192]. L’initiative populaire semble donc avoir eu grande part à cette institution ; et de même que Dieu avait fait choix, au siècle précédent, d’un Pape français pour établir la fête, ce fut de France que se répandit peu à peu dans tout l’Occident ce complément glorieux de la solennité du Mystère de la foi [193].
Il paraît probable toutefois qu’à l’origine la divine Hostie ne fut pas, du moins en tous lieux, portée en évidence comme aujourd’hui dans les processions, mais seulement voilée ou renfermée dans une châsse ou cassette précieuse. C’était l’usage de la porter ainsi dès le XIe siècle en certaines Églises, à la Procession des Rameaux, et encore à celle du matin de la Résurrection. Nous avons parlé ailleurs de ces manifestations solennelles, qui du reste avaient moins pour objet d’honorer directement le Sacrement divin, que de rendre plus au vif le mystère du jour. Quoi qu’il en soit, l’usage des ostensoirs ou monstrances, comme les appelle le concile de Cologne de l’année 1452, suivit de près l’établissement de la nouvelle Procession.
On les fit d’abord plus généralement en forme de tourelles percées à jour ; dans un Missel manuscrit de l’an 1374, la lettre D, première de l’Oraison de la fête du Saint-Sacrement, présente en miniature un évêque accompagné de deux acolytes, et portant l’Hostie du salut dans une tour d’or à quatre ouvertures. Il y eut toutefois une grande et souvent heureuse variété dans ces nouvelles productions de l’art chrétien, qui venaient ainsi compléter à leur heure la collection déjà si riche des joyaux du sanctuaire. Nées spontanément de l’initiative privée des diverses Églises, elles reflétèrent les inspirations multiples de la foi des pasteurs et des peuples. Tantôt ce fuient des croix chargées de pierreries, des crucifix d’argent ou d’or, qui présentèrent sous le Sacrement le vrai corps de l’Homme-Dieu aux regards des fidèles, rappelant en même temps à leur religion et à leur amour le Sacrifice et la mort cruelle qui avaient fait de lui l’Hostie du salut. D’autres fois, au contraire, on employa pour cet usage des statuettes du Seigneur ressuscité incrustées des plus riches émaux, qui proclamaient la gloire du Vainqueur du trépas, toujours vivant et triomphant sous la mort apparente des espèces sacrées : placée dans la poitrine, à l’endroit du cœur, l’Hostie sainte rayonnait des mille feux de la pierre précieuse et translucide qui protégeait ce réduit sacré. Ailleurs, la Mère de la divine grâce, apparaissant de nouveau comme le vrai trône de la Sagesse éternelle, offrait elle-même aux adorations des nations d’Occident ce même Verbe incarné qui avait reçu l’hommage des rois de l’Orient sur son sein maternel ; ou bien encore l’Ami de l’Époux, Jean le Précurseur, portant dans ses bras l’Agneau du salut, montrait au monde, de son doigt prédestiné, l’Hostie sainte qui brillait sur le front de cet Agneau divin comme une perle précieuse. Libre expansion de la piété que respecta l’Église-mère, jusqu’à ce que ces différentes conceptions se trouvassent ramenées par le temps au type uniforme reçu de nos jours. Les XIVe et XVe siècles virent déjà s’établir l’usage prédominant des monstrances à cylindres de cristal engagés dans des édicules de formes variées, à baies ogivales avec arcs-boutants et contre-forts, et surmontés d’élégantes pyramides ou de clochetons ajourés. Bientôt la piété catholique, s’ingéniant à rendre, en quelque sorte, au Soleil de justice les divines splendeurs qu’il dérobe à nos yeux dans le Mystère d’amour, amena l’usage d’exposer l’auguste Sacrement dans un soleil de cristal à rayons d’or ou de quelque autre matière de prix [194]. En dehors de quelques rares monuments plus anciens que nous pourrions citer, cette dernière progression s’affirme clairement dans un Graduel du temps de Louis XII (1498-1515), où la première lettre de l’Introït du Saint-Sacrement renferme un soleil à peu près semblable aux nôtres, porté sur les épaules de deux personnages vêtus du pluvial, et suivi par le roi, accompagné de plusieurs cardinaux et prélats [195].
Cependant l’hérésie protestante, qui naissait alors, traita bientôt de nouveauté, de superstition, d’idolâtrie odieuse, ces naturels développements du culte catholique inspirés par la foi et l’amour. Le concile de Trente frappa d’anathème les récriminations des sectaires [196], et, dans un chapitre spécial, il justifia l’Église en des termes que nous ne saurions nous dispenser de reproduire : « Le saint Concile déclare très pieuse et très sainte la coutume qui s’est introduite dans l’Église, de consacrer chaque année une fête spéciale à célébrer en toutes manières l’auguste Sacrement, comme aussi de le porter en procession par les rues et places publiques avec pompe et honneur. Il est bien juste, en effet, que soient établis certains jours où les chrétiens, par une démonstration solennelle et toute particulière, témoignent de leur gratitude et dévot souvenir envers le commun Seigneur et Rédempteur, pour le bienfait ineffable et divin qui remet sous nos yeux la victoire et le triomphe de sa mort. Ainsi fallait-il encore que la vérité victorieuse triomphât du mensonge et de l’hérésie, de telle sorte que ses adversaires, au sein d’une telle splendeur et d’une si grande joie de toute l’Église, ou perdent courage et sèchent de dépit, ou, touchés de honte et de confusion, viennent enfin à résipiscence » [197].
Mais nous catholiques, adorateurs fidèles du Sacrement d’amour, « avec quelle joie », s’écrie le pieux et éloquent Père Faber, « ne devons-nous pas contempler cette brillante et immense nuée de gloire que l’Église fait à cette heure monter vers Dieu ! Oui ; il semblerait que le monde est encore dans son état de ferveur et d’innocence primitive ! Voyez ces glorieuses processions qui, avec leurs bannières étincelantes au soleil, se déroulent dans les places des opulentes cités, à travers les rues jonchées de fleurs des villages chrétiens, sous les voûtes vénérables des antiques basiliques, et le long des jardins des séminaires, asiles de la piété. Dans ce concours de peuples, la couleur du visage et la diversité des langues ne sont que de nouvelles preuves de l’unité de cette foi que tous se réjouissent de professer par la voix du magnifique rituel de Rome. Sur combien d’autels de structure diverse, tous parés des fleurs les plus suaves et resplendissants de lumière, au milieu de nuages d’encens, au son des chants sacrés et en présence d’une multitude prosternée et recueillie, le Saint-Sacrement est successivement élevé pour recevoir les adorations des fidèles, et descendu pour les bénir ! Et combien d’actes ineffables de foi et d’amour, de triomphe et de réparation, chacune de ces choses ne nous représente-t-elle pas ! Le monde entier et l’air du printemps sont remplis de chants d’allégresse. Les jardins sont dépouillés de leurs plus belles fleurs, que des mains pieuses jettent sous les pas du Dieu qui passe voilé dans le Sacrement. Les cloches font retentir au loin leurs joyeux carillons ; le canon ébranle les échos des Andes et des Apennins ; les navires, pavoises de brillantes couleurs, donnent aux baies de la mer un air de fête ; et la pompe des armées royales ou républicaines vient rendre hommage au Roi des rois. Le Pape sur son trône et la petite fille dans son village, les religieuses cloîtrées et les ermites solitaires, les évêques, les dignitaires et les prédicateurs, les empereurs, les rois et les princes, tous sont aujourd’hui remplis de la pensée du Saint-Sacrement. Les villes sont illuminées, les habitations des hommes sont animées par les transports de la joie. Telle est l’allégresse universelle, que les hommes s’y livrent sans savoir pourquoi, et qu’elle rejaillit sur tous les cœurs où règne la tristesse, sur les pauvres, sur tous ceux qui pleurent leur liberté, leur famille ou leur patrie. Tous ces millions d’âmes qui appartiennent à la royale famille et au lignage spirituel de saint Pierre sont aujourd’hui plus ou moins occupées du Saint-Sacrement : de sorte que l’Église militante tout entière tressaille d’une joie, d’une émotion semblable au frémissement des flots de la mer agitée. Le péché semble oublié ; les larmes mêmes paraissent plutôt être arrachées par l’excès du bonheur que par la pénitence. C’est une ivresse semblable à celle qui transporte l’âme à son entrée dans le ciel ; ou bien l’on dirait que la terre elle-même passe dans le ciel, comme cela pourrait arriver par l’effet de la joie dont l’inonde le Saint-Sacrement » [198].
On chante pendant la Procession les Hymnes de l’Office du jour, le Lauda Sion, le Te Deum et, suivant la longueur du parcours, le Benedictus, le Magnificat, ou d’autres pièces liturgiques ayant quelque rapport avec l’objet de la fête, comme les Hymnes de l’Ascension indiquées au Rituel. De retour à l’église, la fonction se termine, comme aux Saluts ordinaires, par le chant du Tantum ergo, du Verset et de l’Oraison du Saint-Sacrement. Mais, après la Bénédiction solennelle, le Diacre ne renferme pas l’Hostie sainte ; il la dispose sur le trône où les pieux fidèles lui composeront, durant ces huit jours, une garde empressée.
C’est autour d’elle que les Heures canoniales vont rayonner désormais, comme autour de leur centre.
Les secondes Vêpres.
(Pour les textes de l’Office, voir ici. N.d.W.)
Dans le solennel Office du soir, l’Église repasse au pied de l’Hostie les merveilles célébrées en ce grand jour.
Le premier Psaume, Psaume 109 , chante les grandeurs du Christ pontife. Le Seigneur l’a juré : il est Prêtre à jamais selon l’Ordre de Melchisédech. Comme ce roi de justice et de paix, il a choisi le pain et le vin pour éléments de son Sacrifice. Mais sous ces apparences se cachait l’oblation digne en tout du Pontife éternel et de celui qui l’a engendré avant l’aurore. « Le Christ Seigneur, Prêtre à jamais selon l’Ordre de Melchisédech, a offert le pain et le vin. »
Le pain et le vin du Sacrifice annonçaient un banquet. Le second Psaume, Psaume 110 , célèbre ce banquet ineffable où viennent se résumer les merveilles divines ; car le Christ lui-même s’y donne en nourriture à ceux qui le craignent. Que sa louange demeure donc à jamais ! « Le Seigneur miséricordieux a donné, en mémoire de ses merveilles, une nourriture à ceux qui le craignent. »
L’Eucharistie, qui résume tous les bienfaits divins, est en même temps l’Action de grâces la plus parfaite et la seule digne que nous puissions offrir à la suprême Majesté. Si donc à la fin de cette journée, émus des magnificences de la bonté souveraine, nous nous écrions avec le Psalmiste : « Que rendrai-je au Seigneur pour tous ces biens dont il m’a comblé ? » répondons avec lui, dans le troisième Psaume, Psaume 115 : « Je prendrai le calice du salut, j’offrirai l’Hostie de louange. »
Le Psaume suivant, Psaume 127 , relève en accents inspirés la beauté du spectacle qu’offre aujourd’hui la terre. Le bonheur semble avoir repris ce matin possession du monde avec les saintes pensées. L’huile d’allégresse a coulé du Christ chef sur tous ses membres ; l’Église tressaille, à la vue de ses fils rangés autour de la table sainte, comme de jeunes plants d’olivier prêts à produire des fruits de grâce et de sanctification. Puisse cette journée marquer en effet pour Sion le point de départ d’une fertile abondance ! Puisse-t-elle affermir pour jamais la paix dans la cité sainte ! « Que les enfants de l’Église soient comme de jeunes plants d’olivier autour de la table du Seigneur. »
« Gloire à Dieu, paix aux hommes ! » chantaient les Anges à la descente du Pain céleste en Bethléhem. Tels sont en effet, nous l’avons vu, nous le verrons mieux encore, les deux grands fruits de l’Eucharistie. L’Église s’excite elle-même à chanter, dans le cinquième Psaume, Psaume 147 , cette paix qui règne par la grâce de l’Époux sur ses frontières, affermit ses portes et comble ses fils de bénédictions en elle-même. Mais c’est la divine nourriture, c’est le froment des cieux qui produit cette paix merveilleuse, en unissant tous les membres au Christ dans l’unité d’un même corps. « Le Seigneur qui établit la paix sur les frontières de l’Église, nous rassasie de la graisse du froment. »
Le Capitule nous fait entendre de nouveau la grande voix de l’Apôtre des nations rendant son témoignage sur l’institution du Mystère d’amour, et rappelant encore une fois la suprême recommandation du Seigneur : « Faites ceci en mémoire de moi. »
L’Hymne Pange, lingua résume le Mystère de la foi dans une doctrine profonde et concise. C’est elle que l’Église choisit de préférence pour chanter le divin Sacrement ; les deux dernières strophes (Tantum ergo) forment la conclusion obligée des Expositions et Saluts dans le cours de l’année.
L’Antienne qui accompagne le Cantique de Marie est un cri prolongé de reconnaissance pour le banquet sacré de l’union divine, mémorial vivant des souffrances du Sauveur, où l’homme est rempli de grâce en son âme et reçoit, dans son corps même, le gage de la gloire future. La phrase n’est point achevée : l’Église demeure comme en suspens sur ce dernier élan d’un amour qui ne peut trouver ici-bas d’expression suffisante. « O banquet sacré ou est reçu le Christ, renouvelée la mémoire de sa passion, l’âme remplie de grâce, et donné le gage de la gloire future ! Alléluia. »

Textes de liturgies non romaines.
A la fin de cette grande journée consacrée par l’Église latine au triomphe de l’Hostie sainte, nous écouterons l’Église grecque témoigner d’une même foi au divin Sacrement dans les formules suivantes. Elles accompagnent et suivent la Communion, dans la Liturgie ou Messe appelée de Saint Jean-Chrysostome.
AVANT LA COMMUNION.
Je crois, Seigneur, et je confesse que vous êtes le Christ Fils du Dieu vivant, qui êtes venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier.
Recevez-moi aujourd’hui à la participation de votre Cène mystique. Je ne livrerai point le mystère à vos ennemis, je ne vous donnerai point le baiser de Judas ; je m’adresse à vous, comme le larron : Souvenez-vous de moi, Seigneur, en votre royaume.
Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous le toit souillé de mon âme. Mais de même que vous avez daigné descendre en l’étable et reposer dans la crèche des animaux, entrer dans la maison de Simon le Lépreux et recevoir à vos pieds une pécheresse pareille à moi : daignez entrer aussi dans l’étable de mon âme sans raison, et dans ce corps souillé, mort et lépreux. Et comme vous n’avez point repoussé la bouche impure de la pécheresse baisant vos pieds sans tache, ainsi, Seigneur mon Dieu, ne repoussez pas non plus ce pécheur. Mais dans votre clémence et bonté, daignez m’admettre à la communion de votre très saint Corps et de votre Sang.
Pardonnez, déliez, remettez, ô mon Dieu, tous les péchés que j’ai commis sciemment ou par ignorance, en parole ou en œuvre. Soyez-moi propice en votre bonté compatissante ; par les prières de votre Mère très pure et toujours vierge, sauvez-moi de la condamnation, et que je puisse recevoir votre Corps précieux et immaculé pour la guérison de mon âme et de mon corps. Car à vous est l’empire, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
APRÈS LA COMMUNION.
Nous vous rendons grâces, Seigneur très bon, bienfaiteur de nos âmes, de ce que vous nous avez admis aujourd’hui encore à vos immortels et célestes Mystères. Dirigez nos voies, affermissez-nous dans votre crainte, protégez notre vie, donnez à nos pas la sécurité : par les prières et l’intercession de la glorieuse Marie Mère de Dieu toujours vierge, et de tous les saints.
Le Diacre. Justes rendus participants des Mystères divins, saints, sans tache, immortels, plus élevés que les cieux et vivifiants, rendons de dignes actions de grâces au Seigneur.
Le Chœur. Seigneur, ayez pitié !
Le Diacre. Recevez, sauvez, pardonnez, conservez-nous, ô Dieu, par votre grâce.
Le Chœur. Seigneur, ayez pitié !
Le Diacre. Demandons des jours tous parfaits, saints, paisibles et préservés du péché ; recommandons, nous-mêmes, les autres, et toute notre vie au Christ Dieu.
Le Chœur. A vous, Seigneur !
Le Prêtre, élevant la voix. Parce que vous êtes notre sanctification ; et nous vous rendons gloire à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Le Chœur. Amen.
Enfin saluons encore une fois l’Hostie sainte, en lui dédiant cette Séquence, du Missel de Prague, qui, par sa forme, semble tenir comme le milieu entre les compositions Notkériennes et celles des âges postérieurs.
| SÉQUENCE. | |
| Ave, Caro Christi Regis veneranda, | Salut, chair adorable du Christ Roi, |
| Esca gregis novas legis admiranda. | Du troupeau de la loi nouvelle admirable nourriture ! |
| Tu fidelibus, horis omnibus es adoranda, | Les hommages des fidèles vous sont dus à toute heure ; |
| Casto corde, sine sorde, digne manducanda | C’est dignement, d’un cœur chaste, sans souillure, qu’on doit vous manger. |
| Te colit rite Panem vitæ Ecclesia ; | Vous êtes, ô Pain de vie, l’objet du culte de l’Église ; |
| Dux viatorum, et reorum es venia. | Vous êtes le guide des voyageurs, vous êtes le pardon des coupables. |
| Tu, cibus salutis, nos in te satia. | Aliment du salut, rassasiez nous en vous. |
| Tu lapsorum sublevamen orna præsidia. | Vous êtes le relèvement, la défense de ceux qui sont tombés. |
| Tu mœstorum es levamen, cordis lætitia. | Vous êtes la consolation de l’affligé, l’allégresse des cœurs. |
| Nos de mundi miseria duc ad æterna gaudia, | De ce monde malheureux conduisez-nous aux joies éternelles, |
| Ut firmemur præsentia tua, et suavi gloria. Amen. | Pour y jouir à jamais de votre présence et douce gloire. Amen. |
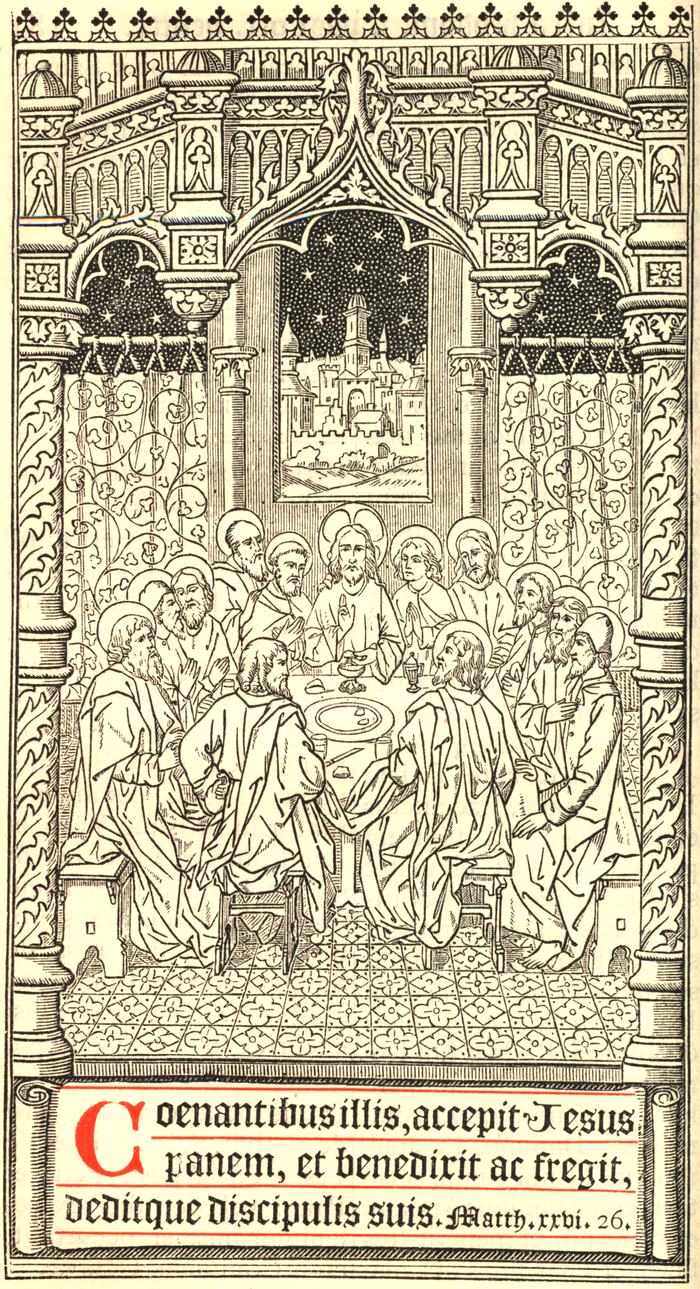
BHX CARDINAL SCHUSTER, LIBER SACRAMENTORUM
Dans l’antiquité, on célébrait trois messes le jeudi saint, l’une pour la réconciliation des pénitents, une autre pour la consécration des saintes Huiles, et la troisième in Cœna Domini pour solenniser l’institution de la très sainte Eucharistie. Bien plus, l’auguste Sacrement de l’autel constituait pour ainsi dire l’idée centrale de l’ancienne liturgie de ce saint jour, à ce point qu’on l’appelait dies paschalis [199], en tant que Jésus-Eucharistie est notre vraie Pâque, Lui qui a été immolé pour nous et est devenu notre sacrifice et notre nourriture. Par la suite pourtant, une si grande splendeur de culte diminua avec le refroidissement de la ferveur des fidèles ; les rites de la communion générale et de la consécration des saintes Huiles se compénétrèrent en une unique messe matinale, et la piété des chrétiens, toute occupée à méditer la Passion du Sauveur, ne fut plus à même de saisir, par une idée fortement compréhensive de l’institution du Sacrifice pascal, la solennité de ce jour mémorable : Natale Calicis [200].
De là vint la nécessité d’une fête spéciale de la sainte Eucharistie, surtout à cause des hérésies qui avaient surgi contre la vérité du mystère ; cette fête fut instituée par Urbain IV en 1264 et étendue par Clément V à toute l’Église.
L’office du Très Saint Sacrement est un chef-d’œuvre de doctrine théologique, d’amour, de goût littéraire ; il a pour auteur saint Thomas d’Aquin, qui toutefois, par humble attachement à la tradition liturgique, voulut employer en partie des antiennes, lectures et répons déjà en usage dans quelques Églises particulières. La procession qui suit la messe devint généralement obligatoire au XVe siècle seulement.
L’antienne pour l’entrée solennelle du célébrant a été empruntée au lundi de la Pentecôte. La fleur du froment dont parle ici le psalmiste, est le Corps très saint de Jésus, formé par le Paraclet avec le sang très pur d’une Vierge immaculée. Il est la fleur du froment, parce que son union hypostatique avec la nature du Verbe, élève cette humanité au-dessus de toutes les autres créatures ; bien plus, celle-ci est proprement la raison d’être et la fin de la création tout entière, en sorte que Tertullien a pu décrire l’Éternel contemplant debout devant Lui son modèle, le Christ, tandis qu’il modelait dans l’argile le corps d’Adam.
La collecte est un chef-d’oeuvre de profondeur théologique, associée à une brièveté incisive d’expression et à une noble élégance. Par là encore on voit bien que saint Thomas n’était pas simplement un théologien, mais qu’il avait un sens littéraire exquis, et qu’il s’était, dirions-nous, comme assimilé le goût liturgique de l’Église. Les collectes composées dans les derniers siècles du moyen âge sont très inférieures par le concept et par l’élégance de l’expression, tandis que celle du Très Saint Sacrement a une saveur presque classique. Ce qui élève de beaucoup sa valeur et démontre le génie de l’Auteur, c’est l’art et la compétence avec lesquels il a su synthétiser en un petit nombre de phrases très heureuses tout un traité sur le Sacrement de l’autel.
« Seigneur qui, grâce à cet admirable Sacrement » — admirable, parce que, à la différence des autres sacrements, qui produisent seulement la grâce au moment où on les reçoit dignement, l’Eucharistie est l’Auteur même de la grâce, lequel, même en dehors du moment du saint Sacrifice ou de la sainte Communion, prolonge sous les voiles eucharistiques sa demeure parmi nous.
« nous avez laissé un mémorial de votre passion » — car le sacrifice de l’autel, non sanglant mais véritable et réel, commémore le sacrifice sanglant du Calvaire dont il est la continuation mystique, et dont il nous communique les mérites. Jésus a voulu instituer l’Eucharistie sous forme de sacrifice pour épancher ainsi son amour, car, après sa résurrection, ne pouvant plus chaque jour, à tout instant, s’immoler douloureusement pour nous, il a du moins établi de nous appliquer continuellement les mérites de sa passion et de sa mort, ordonnant dans ce but aux prêtres de l’offrir sans cesse, jusqu’à sa venue finale le jour du jugement, d’une façon non sanglante, à Dieu le Père, sur les autels pour le salut du monde. Il y a plus. Comme l’acte qui impressionne davantage le cœur humain et qui démontre mieux la charité que Jésus a eue pour les hommes est précisément le mystère de sa mort sur la croix, le Seigneur a établi que cette immolation ne serait pas simplement un fait accompli dans les siècles lointains de l’histoire, et qui maintenant n’éveille plus par conséquent une impression profonde, mais qu’au contraire cet acte de sa suprême charité envers les créatures serait sans cesse renouvelé sur les autels.
La collecte continue : « Accordez-nous, nous vous en prions, de vénérer de telle sorte les mystères de votre Corps et de votre Sang. » — Saint Thomas, en une phrase d’un goût classique très sûr, appelle l’Eucharistie les mystères du Corps et du Sang du Seigneur, car ici il ne s’agit pas d’une froide commémoraison du Calvaire, mais de la présence réelle de ce Corps et de ce Sang qui, sur la balance de la Croix, représentèrent le prix de notre rachat. Saint Augustin appelait à bon droit la messe : Sacrificium pretii nostri [201]. Le fruit spécial qu’aujourd’hui l’Église nous apprend à demander, c’est la dévotion envers la Très Sainte Eucharistie, dévotion qui ne doit pas consister uniquement en prières ou en processions, mais principalement à assurer et à conserver en nous la grâce et l’efficacité de cette Victime de rédemption.
Le passage de l’épître aux Corinthiens (I, XI, 23-29) contient le récit de l’institution eucharistique et parle des graves châtiments auxquels s’expose celui qui s’approche avec irrévérence pour recevoir le saint Sacrement. L’expérience démontre que, comme rien n’est plus utile à l’âme que de recevoir fréquemment la sainte Communion avec les dispositions requises, ainsi rien ne l’expose davantage à l’endurcissement du cœur et à l’éloignement final de Dieu que les communions sacrilèges, surtout quand celles-ci forment une longue chaîne de profanations.
Saint Paul, pour en décrire au vif toute l’horreur, dit que ces malheureux mangent leur propre réprobation, pour indiquer que, comme la nourriture se transforme en la substance de celui qui l’absorbe, ainsi le profanateur de la divine Eucharistie est frappé et tellement envahi par la malédiction de Dieu, que celle-ci, pour ainsi dire, pénètre dans ses os et dans ses moelles et passe jusque dans son sang.
Le verset responsorial est le même qu’au troisième jeudi du Carême. A Cana, le Sauveur avait dit à la sainte Vierge que le temps n’était pas encore arrivé de donner à l’humanité ce vin mystérieux auquel elle faisait allusion, et dont celui qui fut multiplié au festin des noces n’était qu’un simple symbole. Maintenant, dans la plénitude des temps, il donne au peuple chrétien une nourriture et un breuvage divins, prolongeant à travers les siècles de l’histoire de l’Église les mystères de la rédemption accomplie.
Le verset alléluiatique est tiré du texte évangélique : « Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. » Ces deux si nettes affirmations de Jésus contiennent une condamnation anticipée des diverses hérésies qui vinrent nier la présence réelle du Christ dans son Sacrement, réduisant tout à un simple symbole : « Qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Christ, demeurera en moi, et moi en lui. » Moi en lui et lui en moi, parce que le divin Sacrement sera comme le sceau de ma divinité imprimé sur son âme et sur son corps, pour les conformer à moi. Tandis que le Sacrement nourrira son âme par la charité, lui donnant part à ma vie, il la fortifiera aussi contre les assauts de l’adversaire, lequel n’arrivera pas à la détacher de moi.
Suit la splendide séquence du Docteur Angélique, où est résumée toute la doctrine catholique sur la divine Eucharistie. Il était difficile de donner une forme poétique convenable à un thème exigeant la plus exacte et la plus limpide expression théologique. Mais saint Thomas y a réussi.
Dans la lecture évangélique de ce jour (Ioan, VI, 56-59), Jésus explique aux habitants de Capharnaüm les effets spirituels de la Nourriture Eucharistique. De même que le Père, de toute éternité, engendre son Fils de sa propre substance dans les splendeurs de sa sainteté et lui fait part de sa vie, ainsi Jésus dans l’Eucharistie, comme le dit saint Augustin, transforme l’âme en lui-même — non mutabis me in te, sed tu mutaberis in me [202] — et répand en elle sa vie au moyen de la grâce. Alors l’âme eucharistique vit et ne vit pas, tout comme Jésus dans l’Eucharistie s’immole en victime et pourtant vit glorieux. Elle ne vit plus pour elle-même parce qu’avec Jésus elle meurt au vieil Adam ; mais en même temps cette mort mystique ne lui enlève aucune de ses aspirations à la vie, puisqu’elle vit en Jésus d’une vie toute sainte et digne de Dieu. Ainsi précisément l’avait expérimenté saint Paul quand il écrivait : « Je vis, mais ce n’est plus moi qui vis, c’est plutôt le Christ qui vit en moi » [203].
Le verset pour le psaume de l’offertoire est tiré du Lévitique (XXI, 6) et exprime l’éminente sainteté requise du prêtre pour qu’il s’approche dignement de l’autel et y offre, au milieu des fumées de l’encens, les pains de proposition. Ces pains étaient un symbole de l’Eucharistie. Si donc, pour un ministère purement figuratif et symbolique, Dieu prescrivait un si haut degré de sainteté, quelle ne doit pas être maintenant la pureté des prêtres de la Nouvelle Loi, appelés à consacrer par les paroles de leurs lèvres le Mystère du Corps et du Sang du Seigneur, à l’offrir à Dieu, à l’administrer au peuple fidèle en rémission des péchés !
La collecte est très belle et s’inspire du célèbre texte de saint Paul, où l’unique pain eucharistique auquel tous participent, et l’unique coupe consacrée, de laquelle la communauté des fidèles approche ses lèvres, sont représentés comme le symbole de l’unité de foi et de dilection unissant les divers membres du corps mystique de l’Église, qui s’engraissent, selon le mot de Tertullien, à un identique repas divin.
Le début (ou préface) de l’anaphore consécratoire est celui de Noël [204], parce que la divine Eucharistie représente pour nous la continuation du bienfait de l’Incarnation et de la présence corporelle de Jésus sur la terre.
L’antienne pour la Communion — contrairement aux traditions classiques de la liturgie qui veulent que ce morceau musical emprunte son texte au Psautier ou à l’Évangile — est tirée de l’Épître aux Corinthiens. Il y est rappelé que l’offrande du Sacrifice eucharistique célèbre la commémoraison de la mort du Seigneur. Il était en effet de règle chez les anciens que la communauté s’associât au sacrifice qu’elle offrait, en participant à la Victime immolée, de telle sorte que les malades seuls, ordinairement, communiaient en dehors de la messe. Saint Paul établit ici comme une équivalence entre les deux concepts de Communion et de sacrifice commémoratif de la mort de Jésus. C’est pourquoi, bien qu’à parler selon la rigueur des termes théologiques le Sacrifice eucharistique soit accompli par la consécration, il appartient toutefois à son intégrité que celui qui l’offre y participe. Aussi le prêtre qui consacre à la messe est-il tenu de participer réellement aux saints Mystères, encore que la communion spirituelle puisse suffire aux fidèles qui y assistent.
La collecte d’action de grâces exprime un autre fruit de l’Eucharistie, en plus de celui de la paix et de la concorde fraternelle énoncé dans la secrète, et c’est celui d’un droit spécial à la possession de Dieu. Ce droit se fonde sur la fidélité de Dieu et sur les arrhes ou anticipation qu’il concède de lui-même en cette vie, se donnant entièrement à celui qui communie.
La sainte Eucharistie est la preuve suprême de l’amour de Dieu. C’est pourquoi, chez les Orientaux, elle est souvent conservée pour les malades dans une colombe d’or, qui est précisément le symbole de l’Esprit Saint, c’est-à-dire de la divine dilection. De ce caractère tout spécial de l’Eucharistie, et du lien existant entre elle et l’action sanctificatrice du Paraclet, il est facile de conclure à l’énormité du péché que l’on commet en s’en approchant sacrilègement ou en profanant de quelque manière que ce soit, ce Saint des saints. De plus, Jésus, dans la sainte Communion, veut nous donner un gage de la vie éternelle, comme une anticipation de sa possession béatifique au Ciel. Quelle douleur pour son Cœur quand, à cause de la perfidie de Judas et de ses imitateurs, le Pain de vie se change parfois en motif de condamnation et de mort !

DOM PIUS PARSCH, LE GUIDE DANS L’ANNÉE LITURGIQUE
« Le pain vivant qui la vie au monde ».
1. Premières impressions. — Que fêtons-nous, aujourd’hui ? Le nom le dit : Festum Sanctissimi Corporis Christi — la fête du Très Saint Corps de Jésus-Christ. C’est donc la fête du corps du Christ dans l’Eucharistie ou, plus précisément, la fête de l’institution de l’Eucharistie, ce qu’indique bien notre désignation française : la fête du Saint-Sacrement. Cette fête est, en même temps, un hommage au Christ qui, par l’institution de l’Eucharistie, a fait à son Église le plus grand présent. A vrai dire, le jour de l’institution de l’Eucharistie est le Jeudi-Saint. Mais le souvenir de la Passion du Christ ne permet pas une joie festivale ce jour-là. C’est pourquoi une fête spéciale du Saint-Sacrement nous permet de célébrer l’aspect joyeux du Jeudi-Saint. On a choisi, pour cette célébration, le jeudi qui suit la conclusion du cycle pascal.
La liturgie de notre fête a été composée par le grand docteur de l’Église, saint Thomas, sur l’ordre du pape Urbain IV, en l’an 1264. Il est incontestable que nous avons là une œuvre classique de la liturgie. Nous remarquons, cependant, une grande différence entre l’Office de la fête du Saint-Sacrement et celui des fêtes plus anciennes. L’office des fêtes anciennes ressemble à un parc grandiose, mais sauvage ; l’office de la fête du Saint-Sacrement peut être comparé à un artistique jardin à la française. Les fêtes anciennes respirent l’esprit puissant de l’ère des martyrs, mais n’ont pas, d’ordinaire, une construction aussi délicate et artistique. Les fêtes modernes se distinguent par une construction systématique et diverses formes artistiques. La fête du Saint-Sacrement est une fête moderne et elle tient le premier rang parmi ces fêtes. C’est un véritable chef-d’œuvre artistique. Tant dans la prière des Heures que dans la messe, nous rencontrons sans cesse de nouvelles beautés architecturales. Examinons de près cet office classique.
Les Matines commencent par un hommage au Christ-Roi : « Le Christ, le Roi, le Souverain des nations... » Depuis que nous célébrons la fête du Christ-Roi, nous sommes plus attentifs aux textes liturgiques qui proclament sa royauté. Nous le voyons, la Fête-Dieu est aussi une fête du Christ-Roi, un hommage au divin Roi qui, dans l’Eucharistie, règne sur les peuples.
Puis, vient l’hymne. Les hymnes de la Fête-Dieu attestent toutes le grand talent poétique de saint Thomas. Malgré toute son originalité, saint Thomas, dans le rythme et la rime, suit les traces des célèbres compositions lyriques qu’Adam de Saint-Victor (1192) nous a laissées et qui forment l’héritage spirituel de l’abbaye royale des chanoines réguliers de Saint-Victor. Signalons seulement l’hymne des Laudes (Verbum supernum), dans laquelle se trouvent ces vers qui sont un vrai « monument » :
C’est à propos de cette strophe que le poète Santeuil disait qu’il aurait donné toutes ses œuvres pour être l’auteur de ces quatre vers.
Les trois nocturnes des matines doivent marquer une progression.
Le premier représente l’Ancien Testament, et, par suite, nous offre souvent une figure ou un type ; le second traite des pensées de la fête ; le troisième, avec l’Évangile, est le point culminant.
Dans les matines du Saint-Sacrement, les leçons du premier nocturne ne sont pas empruntées à l’Ancien Testament, mais au Nouveau. Par contre, les trois répons nous présentent trois des plus belles figures de l’Eucharistie : l’agneau pascal (1), la manne (2) et le pain cuit sous la cendre, présenté à Élie (3). Saint Thomas montre une véritable maîtrise dans le choix des psaumes et dans le cadre des antiennes, qui semble se présenter de lui-même.
Les leçons du deuxième nocturne ont été composées par saint Thomas lui-même. Elles sont de ces écrits dont le Christ en personne aurait dit : « Tu as bien écrit de moi, Thomas ». Dans les répons de la fête du Saint-Sacrement, nous trouvons une forme artistique spéciale. Tous (à l’exception d’un seul) ont cette particularité qu’une partie est tirée de l’Ancien Testament et l’autre du Nouveau. Dans les répons du premier nocturne, la première contient la figure et l’autre l’accomplissement.
2. Office des Heures. — La fête commence solennellement par les premières Vêpres. Nous voyons devant nous une mosaïque d’images et de figures. Nous voyons « le prêtre éternel selon l’ordre de Melchisédech offrir le pain et le vin » (Ps. 109). Nous voyons le divin Moïse, dans le désert de la vie, « donner le pain à ceux qui le craignent » (Ps. 110). Après la captivité de Babylone qu’était notre état de non rachetés, nous remercions le Seigneur : « Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu’il m’a fait ? Je prendrai le calice du salut » (Ps. 115). Et, maintenant, une charmante image familiale : Le Christ est le père de famille qui, dans un dur travail, nous a gagné notre pain ; l’Église, la mère, est semblable à une vigne fertile. Les enfants, les pousses d’olivier, les jeunes oints — d’autres Christs — sont rangés autour de la table (Ps. 127). Jérusalem est de nouveau en paix ; le Seigneur nourrit ses habitants de la moelle du froment (Ps. 147). « O qu’il est doux, Seigneur, ton esprit, toi qui, pour montrer ta bienveillance envers tes fils, par un pain très doux descendu du ciel, remplis de biens ceux qui ont faim, et renvoies vides les riches dédaigneux, Alléluia » (Ant. Magn.).
Le soir, nous récitons les matines. Nous les avons déjà préparées. Elles coulent dans leur beauté classique, avec leurs antiennes si claires qui nous expliquent immédiatement les psaumes, avec leurs répons si riches de sens et leurs leçons si pleines d’enseignements. Celles du second nocturne ont été composées spécialement par saint Thomas lui-même pour ces matines. « Immenses sont les bienfaits que la générosité de Dieu a accordés au peuple chrétien ; ils lui confèrent une dignité inestimable. Car il n’y a pas et il n’y a jamais eu « un peuple qui a eu ses dieux si proches de lui, comme nous avons notre Dieu près de nous » [205]. En effet, le Fils unique de Dieu a pris notre nature humaine pour nous faire participer à sa nature divine ; pour faire les hommes dieux, il s’est fait homme. Et, en outre, tout ce qu’il a pris de nous, il nous l’a donné tout entier pour notre salut. Car il a offert son corps pour notre réconciliation sur l’autel de la Croix, comme victime, à son Père. Il a versé son sang comme rançon et comme bain purificateur, afin que, rachetés du misérable esclavage, nous soyons purifiés de tous les péchés. Pour que le souvenir perpétuel d’un si grand bienfait nous demeurât, il nous a laissé son corps comme nourriture et son sang comme breuvage, que nous devons prendre sous les espèces du pain et du vin ».
De bonne heure, le matin, nous récitons ou nous chantons les matines. L’idée de cette prière du matin est celle-ci : louange de la nature en union avec le mystère de la fête. Mais aujourd’hui la création a une raison particulière de louer Dieu. Le Christ lui a fait honneur en prenant les dons de la nature, le pain et le vin, pour en faire le voile de sa présence mystique. Si l’humanité se sent honorée par l’Incarnation du Fils de Dieu, la création entière est honorée par l’institution de l’Eucharistie.
3. La messe (Cibavit eos). — Nous célébrons maintenant la messe d’une si belle composition. Nous la célébrerons pendant toute l’Octave. Nous pourrons donc chaque jour en méditer une partie différente. Au reste, chaque morceau est à sa place et très suggestif.
L’Introït est un véritable Introït, une sonnerie solennelle de cloches, une invitation à la solennité de la messe. L’Eucharistie est la moelle du froment, l’aliment de la vie surnaturelle ; c’est le miel, la douceur spirituelle qui sort du rocher qui est le Christ. Le psaume tout entier (que nous connaissons depuis le lundi de la Pentecôte) devrait être récité ici.
L’Oraison est connue, mais il convient de la méditer quelque temps.
L’Épître est celle du Jeudi-Saint. Le passage principal est le récit de la Cène. Les mots les plus importants sont : « Vous annoncerez la mort du Seigneur » (Nous annonçons la mort du Christ, en effet, en rendant présente cette mort).
Les deux chants intermédiaires sont d’une très belle composition. Le Graduel est un texte emprunté à l’Ancien Testament ; le verset de l’Alléluia est un passage du Nouveau Testament. Le Graduel parle de la nature : Dieu, le Père nourricier, sert la table pour ses créatures et celles-ci disent leurs « grâces » ; ce festin que Dieu sert à ses créatures est l’image du banquet divin que chante l’Alléluia. L’Alléluia est le prélude de l’Évangile dont il souligne le verset principal.
La séquence, d’après sa définition, est une méditation du verset de l’Alléluia. Elle passe pour une des plus belles créations de saint Thomas. Cette poésie dogmatique contient toute la doctrine de l’Eucharistie (elle mérite d’être méditée).
L’Évangile nous donne l’essentiel du grand discours de promesse du Christ dont le contenu est : l’Eucharistie, qui est l’accomplissement de la figure de la manne, le pain de vie et le pain du ciel. Saint Thomas exprime cette idée d’une manière classique dans cette parole : panis vivus et vitalis.
L’Offertoire est d’une grande beauté. Nous sommes tous « prêtres royaux » ; nous offrons le pain (notre travail) et l’encens (notre prière) et nous devons être saints.
La secrète est, elle aussi, très riche de sens. Elle explique le symbole des oblats : le pain et le Vin sont le symbole de la paix et de l’unité ; ils ne prospèrent que dans la paix ; beaucoup de grains de blé, beaucoup de grains de raisins s’unissent pour faire la farine et le vin.
L’Eucharistie est le sacrement de la paix et de l’unité avec le Christ. La postcommunion nous conduit déjà à la jouissance céleste de la divinité. De cette jouissance, nous avons le gage et l’image dans l’Eucharistie.
Après la messe a lieu la procession du Saint-Sacrement. Cette procession ne constitue pas l’essentiel de la fête (elle était d’ailleurs inconnue au moment de l’introduction de la fête). C’est pour cela, aussi, que le rite de cette procession n’est pas le même partout. Le rituel romain prévoit bien une procession, mais se contente d’offrir des chants pour cette procession. L’après-midi, nous célébrons les deuxièmes Vêpres, qui sont le chant final de la fête. Les vêpres sont, aujourd’hui, l’action de grâces pour les dons surnaturels de la fête. L’antienne de Magnificat résume tous ces dons (saint Thomas y manifeste tout son génie).
[1] Psalm. CX, 4.
[2] Zach., IX, 17.
[3] Hic stetit D. Guéranger.
[4] Oraison de la fête des Stigmates de saint François.
[5] In Dion. Hierarch. coelest.
[6] La nourriture des âmes.
[7] Johan., XVI, 14.
[8] II Petr., I, 19-21.
[9] Hymn. Pentecost.
[10] Johan., XX, 17.
[11] Luc, XXIV, 49.
[12] Johan., XIV, 26.
[13] Ibid., XVI, 13.
[14] Ibid., XV, 20.
[15] Matth., IV, 4.
[16] Prov., VIII, 31.
[17] III Reg., XIX.
[18] Prov., IX.
[19] III Reg., XIX, 8.
[20] Apoc, XXII, 17.
[21] Similitude de nom qui ne doit pas faire confondre ce jeune frère avec le chanoine Jean de Lausanne, dont nous avons dit plus haut les éminents services.
[22] Vita B. Julianae ab autore coaevo descripta, lib. II, c. 2 ; Act. SS. ad diem Vam Aprilis.
[23] Ibid., in Append.
[24] Psalm. II, 8.
[25] Heb., X, 14.
[26] Serm. VIII de Pass.
[27] Serm. IV de Pass.
[28] Johan., XIII, 34.
[29] Ibid., XVII, 20.
[30] Johan., XVII, 21, 23.
[31] Act. II, 42.
[32] Ibid., 47.
[33] Tertull., Apolog. XXXIX.
[34] I Cor., X, 17.
[35] Serm. CCXXVII. In die Paschae. Ad Infantes, de Sacramentis.
[36] Serm. CCXXIX. Fer. II. Pasch. De Sacrament. fidelium.
[37] Act., IV, 32.
[38] Serm. CCLXII. In die Pentecost. Ad Infant. de Sacrament.
[39] Lib. VIII de Trinit.
[40] Hom. VII.
[41] Serm. II, ad Neoph.
[42] In ep. I ad Cor. Hom. XXIV.
[43] Lib. X in Johan.
[44] De corp. et sang. Domin. Cap. 1.
[45] De div. Off. Lib. II, c. 2.
[46] De Sacrament. Euch. Cap. IV.
[47] Ep. LXIII.
[48] Ep., LXXVI.
[49] Johan., XI, 52.
[50] Tob., VI.
[51] Gen., I, 22, 28.
[52] Johan., XXI, 9.
[53] Paulin. Ep. XIII ; Aug. Confess. XIII, 23 ; Ambr. Hymn. pasc ; Prosp. African. De promission.
[54] Inscript. Augustod. Spicileg. Solesm. I.
[55] De l’aveu général aujourd’hui, cette reine qu’Abercius admire dans la cité impériale, ce peuple au sceau resplendissant : c’est l’Église nuire, que le Psalmiste avait d’avance saluée comme une reine dans l’éclat de son vêtement d’or (Psalm. XLIV) ; c’est le peuple chrétien, marqué au front du signe du Dieu vivant (Apoc, VII).
[56] Titul. Abercii. Spicileg. Solesm. III.
[57] Matth. VII. 6.
[58] Venant. Fortun. Lib. III, carm. 24.
[59] Le mercredi de la IVe semaine de Carême.
[60] I Petr. II, 9.
[61] Ad Smyrn. VIII.
[62] Ad Magnes. VII.
[63] Ad Philadelph. IV.
[64] Apoc. IV, V.
[65] Ap. EUSEB. Hist. eccles. Lib. V, c. 14.
[66] Lib. VII, c. 25.
[67] 200 jours, pour le jeûne ou une œuvre pie remplaçant le jeûne, selon l’avis du Confesseur.
[68] Eph. II, 21.
[69] Heb. V, 1.
[70] Eph. I, 23.
[71] Est-il besoin de dire que ces paroles ne regardent aucunement l’Exposition de l’adorable Sacrement pratiquée dans les conditions prescrites ou encouragées par la sainte Église, mais les abus de langage ou autres dont, bien contre le gré de l’Église, elle est devenue l’occasion pour la dévotion privée de quelques âmes ! Ce n’est point ici le lieu d’apprécier une thèse récente qui voit dans l’Exposition le juge sacrificium (le sacrifice perpétuel) ; nous ne relèverons pas même autrement le terme quelque peu étrange de « vocation eucharistique » appliquée, dans la natio tam grandis qui est L’Église, à une catégorie spéciale de catholiques ; mais nous ne serons pas seuls, croyons-nous, à trouver excessifs des développements comme ceux-ci : « Voilà donc ce qui est promis à tous ceux qui reçoivent l’Eucharistie, promis plus spécialement à ceux qui la reçoivent davantage, et c’est nous... Regardons ce qu’il a fallu à Notre-Seigneur d’amour et de sacrifices pour faire la vocation eucharistique, et pour nous y appeler. Il a fallu d’abord qu’il fit l’Eucharistie, il a fallu qu’il embrassât tout ce que l’Eucharistie suppose d’abaissement, d’anéantissement ; il a fallu qu’il acceptât cela et qu’il le supportât pendant dix-huit cents ans ! Car il est resté dix-huit cents ans en attendant l’heure où quelques-uns seraient spécialement donnés à son adorable présence, pour être ses amis et ses confidents... » Pour nous il faut l’avouer, nous comprenons autrement l’honneur de l’Église ; nous ne croyons pas que le Seigneur ait eu besoin de « dix-huit cents ans de patience » pour trouver enfin « de vrais adorateurs et de vrais amis » !
[72] Matth. VIII, 20.
[73] Ep. LII.
[74] Cant. VI, 11, 12.
[75] Cant. VII, I, 2.
[76] Psalm. XLIV, 6.
[77] CARDINAL PIE. Homélie du 8 sept. 1869, à Issoudun.
[78] Enarrat. in Psalm. XCVIII, 5.
[79] Sap. XVI, 20.
[80] Zach. IX, 17.
[81] Aspiration, on le verra, qui ne relève point de la nature, mais uniquement de ce fait que Dieu a élevé l’homme à l’ordre surnaturel et qu’il le lui a dit.
[82] Johan. III, 9 ; VI, 33.
[83] Prov. VIII, 22-34.
[84] Psalm. LXII, 2.
[85] Psalm. XLI, 2-7.
[86] Psalm. CXLIII, 5.
[87] Psalm. XVIII, 2.
[88] Sap. XI, 21.
[89] I Johan. IV, 8.
[90] I Johan. IV, 10.
[91] Gal. III, IV.
[92] Johan. XIV, 26.
[93] Cf. Psalm. LXVII, 19 ; Eph. IV, 8.
[94] Psalm. CX, 4.
[95] Johan. XIII, 1.
[96] Cant. VIII, 6.
[97] Gen. I, 26.
[98] Ibid. 27.
[99] Sap. VII, 26.
[100] Johan. 1, 3, 4.
[101] Sap. II, 23.
[102] Heb. 1, 3.
[103] CARDINAL PIE. Première Instruction synodale sur les principales erreurs du temps présent.
[104] Gen. 1, 26.
[105] Psalm. LXII, 2.
[106] Psalm. XLI, 2-7.
[107] II Petr. 1, 4.
[108] Rom. VIII, 16.
[109] Eph. 1, 17, 18 ; Rom. V, 2.
[110] Rom. VIII, 26.
[111] Rom. VIII, 27.
[112] I Tim. VI, 16.
[113] Heb. 1, 3.
[114] Johan. III, 16.
[115] Heb. IX, 8.
[116] Psalm. XVIII, 6.
[117] Psalm. XLIV, 5.
[118] Mich. V, 2.
[119] Psalm. XLIV, 3.
[120] II Cor. IV, 6.
[121] Matth. XXII, 21.
[122] Prov. I, 20, 21.
[123] Ibid. VIII, 1-4.
[124] Ibid. IX, 1-5.
[125] Matth. XXII, 4.
[126] Ia ex Ant. maj. Adventus.
[127] Ant. Epiph. ad Benedictus.
[128] Johan. XV, 5.
[129] Eccli. XXIV, 23.
[130] Psalm. LXIV, 14.
[131] Psalm. LXXI, 16.
[132] Sap. VIII, 2.
[133] Eccli. XV, 2, 3.
[134] Prov. VIII, 19.
[135] Eccli. XXIV, 29.
[136] Sap. VIII, 16.
[137] Prov. VIII 18.
[138] Eccli. XXIV, 7.
[139] Ibid. 1-4.
[140] Eccli. XV, 5, 10.
[141] Const. Excellentissimum.
[142] Zach. IX, 17.
[143] Chrys. in Johan.
[144] Zach. IX, 17 ; I Cor. X, 4.
[145] Luc. XII, 36-38.
[146] Rom. V, 9.
[147] Dan. IX, 24, 27.
[148] Psalm. CXVIII, 164.
[149] Eccli. XLVII, 11.
[150] I Paral. XVI, 2.
[151] Ibid. 4, 37, 41.
[152] Ibid. XXIII, 1.
[153] Ibid. XXVIII, 11, 13.
[154] Ibid. XXIII, 3.
[155] Ibid. XXV.
[156] I Paral. XV, 27.
[157] Rupert. De div. Off. Lib. I, c. 17.
[158] Description de la psalmodie avant la réforme de saint Pie X.
[159] Eph. 1, 10.
[160] Description de la psalmodie avant la réforme de saint Pie X.
[161] Psalm. CXVII, 15.
[162] Psalm. CXXXI, 6.
[163] Psalm. CXVII, 27.
[164] Psalm. CXXXI, 3-5.
[165] Psalm. CXXXI, 7.
[166] Psalm. XXI, 28.
[167] Psalm. XCV, 11 -13.
[168] Johan. XVI, 7.
[169] Hymn. Adoro te.
[170] Cant. II, 1.
[171] Psalm. CX, 4-5.
[172] Matth. XXVII, 20.
[173] Johan. VIII, 12.
[174] Le Temps de Noël. Chap. III.
[175] Allusion au rite processionnal bénédictin avant la messe solennelle des jours de fêtes.
[176] Psalm. XVII, 10.
[177] Johan. XII, 24-25.
[178] Conc. Trid. Sess. XIII, cap. VII, can.XI.
[179] Psalm.CXLIV, 15-16.
[180] Johan. VI, 56-57.
[181] Psalm. XXXV, 10.
[182] Johan. III. 16.
[183] Cyrill. Al. in Johan. Lib. IV, cap. 3.
[184] Johan. X, 10.
[185] Cyrill. Al. in Johan. Lib. X, cap. 2.
[186] Johan. VI, 64.
[187] I Cor. V, 6.
[188] Greg. Nyss. Orat. catech. Cap. XXXVII.
[189] Levit. XXI, 6.
[190] Cant. III, 5-11.
[191] Greg. in Cant.
[192] LABBBE, Concil. T. XI, pag. 1680, 1711.
[193] A la suite du concile de 1311, où la fête fut définitivement promulguée, Vienne prit pour armes l’orme surmonté d’un calice et d’une hostie qu’entourent ces mots : Vienna civitas sancta.
[194] Ce fut vers le même temps qu’on vit paraître et s’établir en plusieurs églises la forme actuelle des vases destinés à renfermer les hosties consacrées. On leur donna le nom de ciborium ou ciboire, qui avait été réservé dans l’antiquité au baldaquin ou dôme surmontant les autels, et sous la voûte duquel ou suspendait en beaucoup de lieux la pyxide ou réserve eucharistique. Les formes de ces réserves sacrées avaient jusque là varié suivant les églises, mais en gardant toujours une dimension très restreinte. Aux XIIIe, XIVe et même encore pendant une partie du XVe siècles, les pyxides sont généralement de très petite dimension, parce que, jusque vers le milieu du XVe siècle, elles ne servaient qu’à conserver le petit nombre d’hosties dont on avait besoin pour la communion des malades en danger de mort. Les fidèles en état d’assister aux offices de l’église recevaient la sainte Eucharistie, après la communion du prêtre, avec des espèces consacrées pendant la messe même, et distribuées au moyen de la patène. » E. Reusens, professeur à l’Université catholique de Louvain : Éléments d’Archéologie chrétienne. T. II, p. 354.
[195] THIERS. De l’exposit. du S.-Sacr. Liv. II, ch. 2.
[196] Sess. XIII, can. 6.
[197] Sess. XIII, cap. 5.
[198] Le Saint Sacrement. T. I, p. 4 (traduct. de M. F. de Bernhardt).
[199] Jour pascal.
[200] La naissance du Calice.
[201] « Sacrifice de notre rédemption », Confessions. IX, 12, 32. L’expression sera reprise par Paul VI dans son encyclique Mysterium Fidei de 1965, rédigée contre les erreurs de notre temps sur la conception et de la présence réelle et du saint Sacrifice de la Messe. N.d.W.
[202] « cibus sum grandium : cresce et manducabis me. nec tu me in te mutabis sicut cibum carnis tuae, sed tu mutaberis in me », « Je suis l’aliment des grands ; grandis et tu me mangeras. Et tu ne me changeras pas en toi, comme l’aliment de ta chair ; mais c’est toi qui seras changé en moi. » St Augustin, Confessions, VII, 10.
[203] Gal. 2, 20.
[204] Avant 1960, sauf dans les diocèses possédant une préface propre.
[205] Deut., IV, 7.
 Version imprimable
Version imprimable

